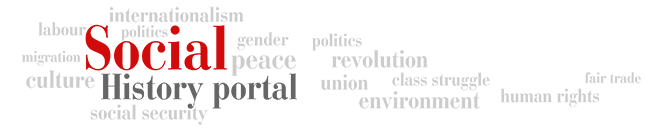Lundi 30 mars 2020 IDHE.S, Université Paris-Nanterre
Organisation : Émilien Julliard (IRISSO), Karel Yon (IDHE.S)
En France, la question des modes de financement des organisations politiques (entendues au sens large de groupements volontaires tels que partis politiques, associations ou syndicats), a étonnamment fait l’objet de peu de recherches en sciences sociales. Hormis le travail pionnier de Sylvain Lefèvre (2011) sur le financement des ONG, quelques travaux de sociologues (Bévort, 1994) et d’historiens (Pigenet, 1995) sur les syndicats, et plus récemment d’économistes (Cagé, 2018) et de politistes (Phélippeau, 2018) sur le champ politique, ce sont surtout des juristes qui se sont penchés sur la question1. Éric Phélippeau évoque trois raisons de ce désintérêt pour les questions financières : il s’agirait d’un objet perçu comme « trop vulgairement “matérialiste” », les données publiques auraient longtemps manqué, et quand elles ont fini par être mises à disposition, leur profusion et leur technicité, appelant des compétences à la fois statistiques et juridiques, ont pu rebuter les non-spécialistes (Ibid., p. 12-14). Michel Pigenet ajoute, à propos des syndicats, « une tradition tenace de discrétion pour tout ce qui touche à l’argent, ce nerf honteux de la guerre sociale » (Pigenet, 1995, p. 63). L’actualité de la question du financement syndical donne l’occasion de tenter d’en finir avec ce « point aveugle » (Bévort, 1994) de la recherche. La mise à l’agenda du problème des finances syndicales depuis les années 2000 n’est pas sans rappeler en effet celle du financement politique vingt ans plus tôt. Suite à la publication de plusieurs rapports2 et à l’émergence de différentes affaires comme celle des caisses noires de l’UIMM3 ou de la supposée censure du rapport Perruchot4, les demandes de « moralisation » et de transparence du financement syndical se sont multipliées. La loi de 2008 réformant les règles de la représentativité syndicale a apporté une première réponse en posant pour la première fois un ensemble de procédures censées garantir la transparence financière des organisations professionnelles, en obligeant les organisations syndicales et patronales à faire certifier et publier annuellement leurs comptes (Adam, 2012). Plus tard, la loi de 2014 a mis en place un fonds paritaire de gestion des financements du dialogue social censé assurer la traçabilité des sources de financement et de leur utilisation (Andolfatto, Labbé, 2015, 2017). On peut cependant s’interroger sur la direction prise par ce processus réformateur, tant les textes semblent mobiliser des visions opposées du syndicalisme et de son « modèle économique » (Radé,
1 Sur le droit du financement de la vie politique, voir la recension des travaux faite dans son ouvrage par Éric Phélippeau (2018). Sur le financement de la vie syndicale, voir par exemple le dossier consacré à la question dans la revue Droit social (2014) : « l’argent, les syndicats et les élus du personnel ». 2 En particulier celui remis par Raphaël Hadas-Lebel au Premier ministre en 2006 : « Pour un dialogue social efficace et légitime : Représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales ». 3 À l’automne 2007, la presse révèle l’existence d’une « caisse noire » au sein de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, alimentée par des entreprises et destinée autant à leur prêter secours en cas de conflit social, qu’à subventionner des organisations syndicales. En février 2014, Denis Gautier-Sauvagnac, le président de l’UIMM, a été reconnu coupable d’abus de bien social par le tribunal correctionnel de Paris et condamné à trois ans de prison, dont un ferme, et à une amende de 375 000 euros. Sa condamnation a été réduite en appel l’année suivante à deux ans avec sursis et 100 000 euros d’amende. 4 En novembre 2011, le rapport préparé par le député centriste Nicolas Perruchot sur « les mécanismes de financement des organisations syndicales d’employeurs et de salariés » fait polémique, notamment par le chiffre qu’il avance : près de 4 milliards seraient consacrés au financement annuel des syndicats. Ce chiffre conçu pour marquer les esprits agrège en réalité des flux de ressources très hétérogènes dont la majeure partie, liée aux coûts de la représentation du personnel et du « dialogue social », ne transite même pas par les caisses des organisations syndicales. Rejeté par la commission d’enquête qui l’avait commandé, le rapport n’est pas publié mais sera malgré tout diffusé dans la presse.
2014).D’un côté, la loi de 2008 valorise le principe d’organisations autosuffisantes, financées par les cotisations des adhérents. L’exposé des motifs précise ainsi que « les cotisations provenant de leurs adhérents doivent représenter la partie principale de leurs ressources car elles constituent la seule véritable garantie d’indépendance. » De l’autre, tout en réaffirmant ce principe d’autonomie financière des organisations professionnelles, la loi de 2014 entérine la place centrale des financements publics et mutualisés abondés par les entreprises, au nom des « missions d’intérêt général » que les organisations professionnelles exercent dans le cadre du paritarisme, du suivi des politiques publiques et de la formation économique, sociale et syndicale5. Selon certains chercheurs, cette contradiction ne serait qu’apparente. Les obligations de transparence imposées aux syndicats seraient purement formelles, et la mise en place du fonds paritaire pour le financement du dialogue social aurait surtout entraîné un accroissement des subventions aux organisations professionnelles, au détriment des cotisations (Andolfatto, Labbé, 2017). Les études sur l’encadrement du financement de la vie politique ont déjà noté le décalage entre les intentions et la réalité des pratiques, l’idéal de transparence étant souvent un « idéal en trompe-l’œil » qui permet de « répondre à l’injonction réformatrice en mettant en avant un principe fort, mais adossé à un cadre juridique dont les ingrédients en amoindrissent la portée » (Phélippeau, 2018, p. 111, 242) ; une situation qui s’explique par le fait que les acteurs politiques sont à la fois juges et parties vis-à-vis de ces réformes (Ibid., p. 237). Doit-on pour autant en tirer la conclusion que les nouvelles règles de financement de la « démocratie sociale » ont été taillées sur mesure pour des « partenaires sociaux », qui auraient « acquis un quasi-pouvoir législatif sur leurs propres affaires », et qu’elles renforcent avant tout la « cartellisation » du syndicalisme à la française (Andolfatto, Labbé, 2017) ? Les travaux sur la « mise en transparence » des organisations politiques suggèrent un point de vue plus nuancé, en soulignant un resserrement progressif des contraintes : quand bien même les exigences de la réglementation sont floues et formelles dans un premier temps, elles forment un socle sur la base duquel peuvent s’ériger ensuite des procédures de contrôle plus serrées, comme en témoignent l’effort de définition des postes de la comptabilité partisane en France (Phélippeau, 2018), ou syndicale aux États-Unis (Julliard, 2018a). Ces exigences conduisent en outre les organisations à développer leur expertise en matière de gestion comptable et à faire appel à des professionnels extérieurs au champ syndical pour remplir leurs obligations (Ibid. ; Bourguignon, Yon, 2018). Elles peuvent enfin constituer des ressources symboliques dont se saisissent de multiples acteurs, qu’il s’agisse de luttes politiques internes aux organisations (Julliard, 2018b) ou de croisades morales tournées vers le public. La notion de cartellisation, parce qu’elle met l’accent sur la dépendance des organisations aux financements de l’État, a pu ainsi servir « de point d’ancrage à une série de critiques politiques, à l’encontre de tout financement public de la vie politique, oubliant du même coup un peu vite les arguments ayant pu justifier l’introduction de ces subsides étatiques (lutte contre la corruption, reconnaissance positive du rôle joué par les partis dans des systèmes démocratiques notamment) » (Phélippeau, 2018, p. 219). Il convient donc d’étudier le financement des organisations syndicales en évitant toute lecture univoque, ce qui suppose un double effort. En premier lieu, un effort d’accumulation empirique : il s’agirait de documenter davantage et plus précisément la diversité des mécanismes de financement et des flux de ressources qui alimentent les organisations syndicales. Doivent également être pris en compte un ensemble d’institutions dont les
5 « Publication du rapport annuel 2017 sur l’utilisation des crédits du fonds pour le financement du dialogue social », communiqué de presse de l’Association de gestion du fonds paritaire national, 18 décembre 2018.
ressources financières sont importantes et qui sont plus ou moins directement liées aux syndicats : fonds de pension et d’assurance-santé, voire banques, dans le syndicalisme états-unien ; mutuelles ; comités sociaux et économiques (CSE) et institutions paritaires en France, etc. Les réformes citées plus haut évoquent déjà trois sources possibles de financement du syndicalisme : par les cotisations individuelles, par les subventions publiques et par les contributions des entreprises. Au-delà des cotisations, les ressources propres des syndicats ont pu être augmentées de contributions volontaires exceptionnelles, comme le rappelle la longue histoire de la solidarité ouvrière internationale (Delalande, 2019) ou d’institutions comme la Caisse nationale d’Action syndicale de la CFDT (Chappe et al., 2018). Ces contributions peuvent cependant prendre des formes nouvelles, quand il s’agit par exemple d’abonder la cagnotte en ligne d’une caisse de grève (Rosenman, 2019). Les fonds provenant des entreprises peuvent de même avoir des statuts variables, entre des financements directs définis dans le cadre licite d’accords collectifs (Dirringer, 2015 ; Nadal, 2014), et d’autres, moins officiels, consacrés à « fluidifier les relations sociales », pour reprendre une expression consacrée au moment du scandale de l’UIMM. Mais les ressources du syndicalisme peuvent aussi relever du salaire quand, par exemple, le temps de représentation syndicale est reconnu comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Ces différentes sources de financement et leur importance respective varient fortement suivant les contextes nationaux. Dans certains pays, comme aux États-Unis, le financement des organisations syndicales provient essentiellement des cotisations (Chaison, 2006). Au contraire, dans d’autres pays où les syndicats ne représentent pas exclusivement leurs membres, comme en France, ou bien se voient déléguer par l’État la réalisation de certaines missions, comme l’administration du chômage dans les pays nordiques et la Belgique (Van Rie, Marx et Horemans, 2011), les sources de financement sont beaucoup plus nombreuses et répondent à des logiques multiples. On l’aura compris, nous utilisons la notion de « ressource » dans son acception restreinte, au sens des moyens financiers qui sont à la disposition des acteurs syndicaux. Ce faisant, nous nous distinguons de l’usage extensif en vigueur dans la sociologie des mouvements sociaux avec la théorie de la « mobilisation des ressources », qui identifie sous ce terme l’ensemble des éléments utiles à l’action collective. Une telle acception a parfois donné lieu à des tentatives de classification hasardeuses des ressources, au sens où elles se trouvent détachées de leur valeur contextuelle (Pierru, 2010) : l’argent serait ainsi la ressource matérielle la plus fongible (McCarthy et Edwards, 2004). Mais d’autres travaux ont bien mis en évidence que la nature des ressources, selon qu’elles soient endogènes ou exogènes au groupe, façonne les organisations de mouvement social. Il est ainsi admis que le financement par des fondations engendre une canalisation des modes d’action et des revendications (Jenkins, 1998) ou, tout du moins, qu’il participe à dessiner l’espace des organisations mobilisées autour d’une cause (Bartley, 2018). Ce mode de financement conduirait aussi à professionnaliser les organisations militantes, au sens d’une division accrue du travail et des compétences requises pour répondre dans les formes aux appels de ces financeurs (Jenkins et Hacli, 1999 ; McCarthy, 2004). Ces travaux restent toutefois prisonniers d’une logique interprétative binaire en termes de dépendance ou d’indépendance et pointent ce faisant vers le second effort requis, celui de la clarification théorique. À l’encontre d’une analyse se contentant de faire la part entre les ressources propres des syndicats et les financements extérieurs, il semble indispensable de prendre en compte les dimensions culturelles et politiques des ressources. Dans le sillage de la théorie du « marquage social » de la monnaie, qui a montré que les ressources, transferts et dépenses monétaires pouvaient être investis dans les rapports sociaux de significations multiples (Zelizer, 2005), le parti pris de cette journée d’étude est de réfléchir aux enjeux politiques des finances syndicales. Dans quelle mesure les modes de financement participent-ils à la définition du syndicalisme, de son périmètre de représentation, de ses répertoires d’action et d’organisation ? Quelle place les acteurs syndicaux accordent-ils aux réflexions sur les ressources financières ? Dans quelle mesure la question des finances syndicales est-elle un enjeu de luttes politiques, dans le champ syndical et au-delà ? Pour nourrir cette réflexion – et justifier la délimitation du périmètre de cette journée d’étude aux organisations syndicales ou parasyndicales – nous nous inspirons librement d’une grille d’analyse construite dans le but d’analyser le salariat, celle des « régimes de ressources » (Friot, 2009). « La détermination des statuts sociaux par la nature de la ressource, qu’il s’agisse de la rente, du profit ou du salaire, est une question classique depuis le début des sciences sociales. » (Ibid.), bien que délaissée progressivement par les sociologues au profit des économistes. Renouant le fil de cette analyse, l’approche par les régimes de ressources entend développer une « grammaire des ressources ». En d’autres termes, il s’agit de réfléchir à la façon dont la nature des ressources conditionne le statut des acteurs sociaux, les droits dont ils disposent ainsi que les institutions avec lesquelles ils interagissent (syndicats, État, institutions financières, etc.). En fonction des configurations de ressources à une période donnée, il est possible de dégager des régimes de ressources différents. Si l’approche par les régimes de ressources a été développée pour questionner la mutation des droits dits sociaux, qui affecte tant le statut des individus que les institutions qui les portent, il paraît pertinent d’étendre cette grille d’analyse aux institutions syndicales. Il s’agirait alors de réfléchir au lien entre les politiques publiques et les dispositifs juridiques qui organisent les flux monétaires des ressources financières des syndicats, aux légitimités qui sous-tendent ces configurations, et aux identités et modalités d’action qu’elles rendent possibles.
Les communications pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :
1) Comment enquêter et à partir de quelles sources sur les finances du syndicalisme ? À la différence des fondations philanthropiques qui ne rendent guère de comptes publics sur leurs activités (Depecker, Déplaude et Larchet, 2018), le syndicalisme a pu faire l’objet dans certains pays de politiques de mise en transparence financière de sa comptabilité (en France depuis 2008, aux États-Unis dès 1959). Les documents comptables peuvent ainsi constituer un matériau précieux pour décrypter le fonctionnement d’une organisation (Haegel, 2012, p. 127171 ; Julliard, 2018c, p. 422-430). Que nous apprend ce type de documents ? Quelle est leur validité ? Que peuvent en faire les sciences sociales ?
2) Les politiques publiques relatives aux finances des organisations syndicales et la mise en problème public du financement des syndicats. Loin d’être déterminées par les seuls acteurs syndicaux, les ressources financières des syndicats et leurs usages intéressent les pouvoirs publics et les acteurs patronaux. C’est ce qu’illustrent par exemple les mobilisations d’acteurs patronaux, de journalistes et du personnel politique états-unien pour rendre facultative l’adhésion à un syndicat pourtant reconnu dans un site de travail et à plaider en faveur d’une transparence des comptes, au motif de pratiques de corruption et de rackets (Dixon, 2008 ; Shermer, 2009 ; Witwer, 2009). Quelle est la dynamique des controverses sur le financement syndical ? Dans quelle mesure contribuent-elles à transformer les représentations légitimes du syndicalisme ? Quels sont les acteurs et arènes décisifs dans la définition des modes de financement syndical ?
3) En rentrant dans la boîte noire des organisations syndicales, il s’agira de faire une analyse des acteurs qui contrôlent et mobilisent les ressources financières au sein des appareils, ou encore des multiples manières dont sont pensées les finances syndicales (constituées ou non en « politique financière » adaptée aux buts et objectifs poursuivis par exemple). Il s’agira aussi de comprendre, davantage dans une optique de sciences sociales critiques des dispositifs de gestion (Panozzo, Zan, 1999), comment les finances des syndicats sont instrumentées (par exemple via des logiciels comptables de traitement des cotisations syndicales) et avec quels effets. Dans quelle mesure la question des ressources, de leurs origines et de leur gestion faitelle débat dans les syndicats ? Quels sont les acteurs investis dans la définition des politiques financières ? Quel rôle jouent les professionnels extérieurs au monde syndical (expertscomptables, commissaires aux comptes…) dans ces affaires ?
4) Enfin, les effets des types de financements des syndicats sur les rapports au syndicalisme chez les travailleurs (adhérents ou non) et les syndicalistes – par exemple en qui concerne leur rémunération (Sandver, 1978) – paraissent une entrée particulièrement pertinente. En effet, les ressources définissent à la fois le statut de l’institution syndicale et le rapport de différents acteurs à celle-ci. On pense au cas du « chèque syndical », un dispositif de financement promu par la CFDT et testé dans quelques entreprises (notamment Axa) qui combine le soutien de l’entreprise et l’implication des salariés, conçus comme consommateurs sur un marché de la représentation (Bourguignon et Floquet, 2016, 2019). Dans quelle mesure différents types de financement conditionnent-ils des rapports différents entre salariés et syndicats ? Le rapport des permanents syndicaux à leur organisation varie-t-il selon qu’ils sont salariés de celle-ci ou mis à disposition par leur employeur d’origine ?
Les propositions de communication devront être soumises aux organisateurs de la journée d’étude pour le lundi 27 janvier 2020 au plus tard, sous la forme d’une intention de 3 000 signes, bibliographie non comprise. Les communicant.es dont les propositions auront été retenues en seront informé.es aux alentours du 10 février. Une ébauche de communication de 15 à 20 000 signes (bibliographie non comprise) devra ensuite être transmise aux organisateurs pour le lundi 16 mars au plus tard, afin de nourrir les discussions collectives. Des textes plus conséquents seront demandés à l’issue de la journée d’étude dans la perspective d’une publication.
Émilien Julliard : emilienjulliard@gmail.com
Karel Yon : karel.yon@parisnanterre.fr