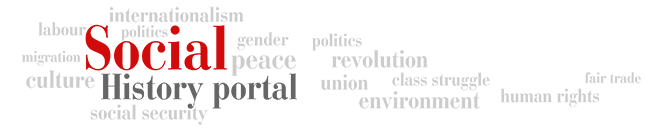Ce colloque interdisciplinaire, à la croisée de l’histoire, de la philosophie, de la sociologie et du droit, se propose de remettre la focale sur cette dimension politique et critique portée par des coopératives de production en choisissant comme porte d’entrée la question juridique. Ouvert aux contributions portant sur la France et sur l’international, il prend pour objet ce que nous appelons ici, pour des questions de praticité, des « coopératives de travailleuses et travailleurs ». Nous entendons par là les coopératives possédées et gérées (au moins en grande partie) par les travailleur·se·s eux-mêmes – qu’elles prennent la forme des associations ouvrières, des coopératives de production (Scop), des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic), des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE), des Sociétés anonymes de participation ouvrière (SAPO) – et portant un projet économique et politique alternatif aux entreprises capitalistes.
Argumentaire
Le développement actuel de l’Économie Sociale et Solidaire a pu produire des effets de dépolitisation du mouvement coopératif, encourageant à la fois son intégration dans l’économie de marché et un affaissement des exigences démocratiques dans son fonctionnement[1]. À ses commencements au XIXe siècle, il s’agissait pourtant pour nombre d’ouvriers et ouvrières associé·e·s dans des coopératives de production de s’affranchir du salariat, de s’auto-instituer démocratiquement et de résister aux processus de prolétarisation induits par l’essor du capitalisme industriel. Plus généralement, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, certaines coopératives ont pu être conçues à la fois comme des lieux d’expérimentation de pratiques et d’imaginaires anticapitalistes[2], et à la fois comme des espaces où s’élaborent des pratiques de souveraineté populaire dans le cadre du travail.Ce colloque interdisciplinaire, à la croisée de l’histoire, de la philosophie, de la sociologie et du droit, se propose de remettre la focale sur cette dimension politique et critique portée par des coopératives de production en choisissant comme porte d’entrée la question juridique. Ouvert aux contributions portant sur la France et sur l’international, il prend pour objet ce que nous appelons ici, pour des questions de praticité, des « coopératives de travailleuses et travailleurs ». Nous entendons par là les coopératives possédées et gérées (au moins en grande partie) par les travailleur·se·s eux-mêmes – qu’elles prennent la forme des associations ouvrières, des coopératives de production (Scop), des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic), des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE), des Sociétés anonymes de participation ouvrière (SAPO) – et portant un projet économique et politique alternatif aux entreprises capitalistes.
Ces coopératives de travailleur·se·s ont bien souvent – mais pas toujours – dû se doter de statuts juridiques. Leur élaboration a pu constituer autant de mises à l’épreuve de leurs principes politiques face aux contraintes du droit qu’il soit civil ou commercial. Ce dernier a pu être perçu par les travailleur·se·s comme un cadre coercitif à contourner, un savoir exogène à s’approprier, ou un garde-fou au risque d’anomie. S’intéresser aux relations entre droit et coopératives de travailleur·se·s implique de distinguer deux sources de droits. Le premier est celui fondé par des textes d’origine étatique. Le deuxième renvoie au droit interne aux coopératives. Ces dernières produisent en effet elles-mêmes du droit, ce qui suppose un travail d’élaboration par des théoriciens et des techniciens des textes juridiques (à l’image de François Espagne pour les Scop) mais aussi des formes de réappropriation par les coopérateurs·rices des statuts-types. Il existe également les règlements intérieurs, qui viennent instituer des règles organisationnelles plus quotidiennes. Parce qu’elles forment l’architecture fondamentale de ces « petites sociétés », les différentes règles élaborées par ces organisations démocratiques relèvent bien d’une forme de constitution politique, ainsi que nous invitent à le penser les travaux analysant les entreprises par le prisme de la théorie politique[3] (political theory of the firm).
Le droit des coopératives de production, son histoire et ses enjeux, est un objet relativement peu étudié[4]. Ce relatif désintérêt s’explique sans doute par le fait que les chercheurs·euses et les acteurs·rices de l’Économie Solidaire et Solidaire tendent à estimer que la « vie » démocratique des coopératives n’existe qu’en marge des structures instituées. On en veut pour preuve le fait que les assemblées générales sont souvent considérées comme de simples « chambres d’enregistrement » de décisions prises en amont lors de temps informels. Le droit applicable aux coopératives ne mériterait pas qu’on s’y attarde, car on ne peut espérer qu’il exerce une quelconque influence sur les pratiques. Ce point de vue sous-estime pourtant les effets du droit. En prescrivant des modalités de fonctionnement ou de gouvernance, des institutions internes, des principes auxquels les coopératives doivent se conformer, le cadre légal délimite le champ des possibles pour les coopérateurs·rices et guide leurs pratiques et les orientations de leurs sociétés. Le grand débat qui a agité le monde de l’Économie Sociale et Solidaire français dans le cadre du vote de la loi ESS en 2014 a finalement révélé au grand jour cet aspect du droit. Car la question qui animait ses membres (faut-il intégrer dans sa circonférence d’autres statuts juridiques que les statuts juridiques historiques ?) était, en partie au moins, relative à cette fonction normative du droit. Les partisans de l’ouverture du périmètre de l’ESS brandissaient le slogan « statut ne fait pas vertu » et revendiquaient l’intégration d’ « entreprises à but social », quitte à compromettre quelque peu l’idéal démocratique ou anti-capitaliste de l’ESS. Les partisans du maintien des statuts historiques estimaient que ces derniers, malgré leurs imperfections, représentaient dans tous les cas des garde-fous essentiels, qui ancraient ces organisations dans la défense de valeurs qui font leur spécificité[5] . Le rapport au droit des coopérateurs·rices évolue bien entendu en fonction du contexte historique[6]. En raison de la loi le Chapelier, les premières associations ouvrières de production ont bien souvent été formées par le biais d’un contrat passé entre les membres sous seing privé, sans que le contrat ne soit légal, comme ce fut le cas pour l’association des bijoutiers en doré. Malgré cela, lorsqu’en 1831 Philippe Buchez présente un « Plan général du mode de travail par association », c’est en proposant de s’appuyer sur les statuts des sociétés particulières de l’époque, faisant référence à l’article 1842 du Code civil et 48 du Code de commerce. Il apparaît qu’une des spécificités de l’association ouvrière du XIXe siècle par rapport à des formes d’organisation « coopérative » de la production qui ont existées précédemment (fruitières du jura, Mines de Rancié, etc.) est de s’appuyer, pour beaucoup d’entre elles du moins, sur les statuts juridiques des sociétés civiles. Ce processus est renforcé lors de la Seconde République instaurée par la révolution de 1848. Dans le contexte d’un essor sans précédent des coopératives ouvrières de production, le vote par l’Assemblée en juillet 1848 d’un crédit voué à soutenir les associations ouvrières et l’attribution de ce financement par un « Conseil d’encouragement » a en effet impliqué la diffusion de statuts juridiques officiels visant à encadrer et contrôler les associations de travailleur·se·s. Après le coup d’état de 1851 qui a violemment réprimé les associations ouvrières, le mouvement coopératif connaît une nouvelle impulsion à partir de 1864, date où est abrogée la loi instituant le délit de coalition. Avec la loi de 1867, les coopératives se voient pour autant à nouveau encadrées par le pouvoir en place, alors même que des coopérateurs·rices socialistes et libertaires tentent de défendre le potentiel émancipateur de ces formes d’organisation du travail face à des libéraux cherchant de les récupérer et à les dépolitiser[7]. Il s’agira alors de comprendre en quoi les statuts des coopératives de travailleur·se·s se distinguent des statuts des sociétés commerciales du XIXe à nos jours. En ce qui concerne les coopératives de production par exemple, différents textes juridiques sont venus encadrer leur activité. On pense notamment à la loi de 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et l’organisation du travail en France ; la loi-cadre portant statut de la coopération de 1947 ; la loi de 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, la loi de 2001 définissant la Scic ou à la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le législateur a volontairement laissé aux coopérateurs·rices une marge de manœuvre importante concernant l’aménagement des statuts. Mais il a aussi rendu certaines dispositions obligatoires[8], qui lui paraissaient relever de l’essence même des coopératives, de leur raison d’être politique.
Ce colloque, qui se propose de rassembler des chercheurs·euses de différentes disciplines mais aussi des acteurs·rices du monde coopératif (membres de coopératives, organisations visant à fédérer ou à soutenir les coopératives), a ainsi vocation à étudier l’évolution et la multiplicité des rapports au droit des coopératives portant un projet politiquement et économiquement émancipateur. Ces derniers nous paraissent en effet éclairer ce qu’implique l’expérimentation concrète d’une alternative critique dans le cadre des sociétés capitalistes. Autrement dit de ce que signifie faire vivre au jour le jour, dans ses aspects pratiques, l’utopie d’une organisation égalitaire et démocratique du travail[9].
Axes
Les personnes qui souhaiteraient proposer une contribution sont invitées à s’intégrer dans un ou plusieurs de ces quatre axes :
Axe 1 : Le statut juridique, une contrainte pour les coopératives de travailleur·se·s
Ce colloque pourra amener à mettre en lumière l’influence du régime légal sur les coopératives de travailleur·se·s. Il conviendra par exemple de se demander si la reconnaissance de ces coopératives par le droit et la mise en place d’un statut juridique dédié ne constitue pas une « légalisation » au sens développé par Bernard Edelman[10], c’est-à-dire une « mise au pas », une réduction de leur capacité d’agir. Cela est d’autant plus évident pour les travailleuses associées du XIXe siècle, notamment les femmes mariées assujetties par le Code Civil, pour qui le droit constitue une réelle entrave à leur volonté d’autonomie. De même, les règlements produits par les coopératives ont pu reproduire des rapports sociaux de domination en instaurant au sein des coopératives des règles d’exclusion (des femmes, des ouvriers non-qualifiés ou temporaires, des étranger.ères…).
Par ailleurs, d’un point de vue juridique, les Scop sont des sociétés commerciales traditionnelles, ce qui peut les forcer à adopter certaines pratiques s’éloignant de leurs idéaux démocratiques (on pense ici au fait que les membres des Scop doivent posséder une part sociale, ce qui peut nuire à leurs principes d’égalité démocratique). Le cadre légal est-il réellement une contrainte pour les coopératives affirmant un objectif anticapitaliste, ou le droit applicable dispose-t-il d’un caractère plastique offrant une large place à la pratique ? Enfin, cette question de l’encadrement par le droit pose celle de potentielles réformes relevant de choix idéologiques ou politiques contraignants, à l’instar la loi de 1978 qui a essayé de rendre plus facile le respect du principe de la double-qualité dans les Scop[11].
Axe 2 : Le droit au service des travailleur·se·s ? Les bénéfices du cadre légal
Mais le cadre légal peut aussi avoir des fonctions utiles pour les travailleur·se·s. Sur le plan de la lutte politique, l’intérêt du statut légal est de permettre à certaines coopératives de créer un interstice dans le fonctionnement actuel du capitalisme afin, comme le dit le sociologue Erik Olin Wright[12], d’éroder ses structures et d’ouvrir la voie de la rupture dans un objectif d’émancipation sociale à long terme. Issues d’une lutte importante contre les licenciements, les coopératives Viome en Grèce et celle visant à reprendre l’ex-usine GKN en Italie montrent actuellement qu’il est possible de réorienter écologiquement la production.
Sur le plan organisationnel, cette « marge de manœuvre » organisationnelle offerte par le législateur aux coopérateurs·rices est-t-elle investie et si oui, comment ? Quels sont les raisonnements politiques qui mènent les travailleur·se·s à l’acceptation ou à la modification des statuts-types qui leur sont souvent fournis ? Le cadre juridique a pu être perçu comme un moyen de réguler les rapports de pouvoir internes à la coopérative découlant notamment de la hiérarchie professionnelle, des dominations de genre, des inégalités entre nationaux/étrangers, associé.es statutaires/auxiliaires. Ainsi la règle du « une personne égale une voix » peut aussi être conçue comme le garant statutaire de la norme démocratique au sein de ces coopératives. Dans quelle mesure d’autres règles que les coopérateurs·rices décident d’inclure dans leurs statuts relèvent-ils de prises de positions politiques ? Au-delà des règles statutaires à proprement parler et des contrats déclarés, nous aimerions aussi porter l’analyse sur les règlements internes. Comment viennent-ils compléter les statuts sur des règles de fonctionnement (par exemple sur la rotation des postes, sur les horaires, le télétravail, la hiérarchie des salaires) ?Nous aimerions également ne pas limiter l’étude à celle des textes réglementaires mais élargir à la question de la circulation des savoirs juridiques. On sait par exemple que les acteurs·rices chargé·e·s de cette fonction peuvent avoir un pouvoir important en orientant, sciemment ou non, les pratiques démocratiques, souvent vers une acceptation de formes très représentatives[13]. Comment les travailleur·se·s sont conseillé.es sur les règles juridiques ? Comment se réapproprient-ils ce savoir ? Qui sont les « passeur·se·s » du droit, au XIXe siècle comme aujourd’hui ? En outre, les outils de « pédagogie du droit » font-ils parfois plus qu’expliquer les possibilités techniques du droit, par exemple en comprenant des éléments d’élaborations normatives (nous pensons par exemple au Guide juridique des Scop) ?
Axe 3 : Les coopératives de travailleur·se·s contre le droit étatique
Cet axe se propose d’explorer, dans sa radicalité, le rapport conflictuel aux droits expérimenté par des coopératives. On pense notamment aux coopératives de prolétaires qui s’établissent particulièrement aux périodes du XIXe siècle durant lesquelles l’interdiction des associations et des coalitions sont les plus rigides. Comment ces coopératives s’organisent-elles malgré le droit et en dépit d’un régime juridique hostile ? Quelles formes légales utilisent-elles pour contourner les interdictions ? Font-elles le choix de l’illégalité ?
Ainsi, cet axe sera l’occasion d’évoquer des coopératives inspirées par le courant libertaire ou anarchiste qui entendent refuser le régime légal, qu’elles s’inscrivent au sein des communautés intentionnelles du XIXe siècle ou des mouvements anticapitalistes, féministes, écologistes contemporains. Ces coopératives qui ne font pas appel au droit s’appuient-elles pour autant sur des règlements ? Quels sont les effets de ce choix sur les pratiques autogestionnaires et sur l’inscription dans la durée de ces coopératives ?
Axe 4 : Perspectives normatives : quels statuts pour les coopératives de demain ?
Le législateur a fait en sorte que le cadre juridique des coopératives de travailleur·se·s soit assez flexible pour tolérer une vaste gamme de pratiques. On peut se demander si cela n’a pas nuit au respect des fondements mêmes de ces coopératives. Par exemple, dans le droit des Scop, il n’est pas indiqué de limite au pourcentage de travailleur·se·s non-associé·e·s. Cela a pu conduire certaines Scop à passer sous la barre des 50 % du sociétariat, le plus souvent suite à des rachats de filiales non-coopératives (comme Mondragon en Espagne[14] mais il existe des cas en France également). Un autre exemple, propre aux États-Unis cette fois, concerne l’absence de clause juridique interdisant la revente à profit des coopératives de production (présente a contrario dans le droit français), qui a engendré la revente à prix d’or des « coopératives Plywood » de la côte Ouest[15].
Quelques rares propositions de « jardinage du droit coopératif » ont vu le jour ces dernières années[16]. Dans quelle mesure le droit des coopératives de production devrait-il être réformé afin de leur permettre de mieux respecter les idéaux démocratiques et anti-capitalistes qu’elles se donnent ? Par exemple, le système des collèges est-il plus démocratique que la règle du « une personne égale une voix[17] » ? Doit-on remettre en question le lien salarial (sur le modèle des coopératives de travail associé espagnoles[18]), qui semble aller de soi aujourd’hui en France, alors même que le but originel des coopératives de production était de l’abolir ?
Nous souhaiterions également aborder la question actuellement débattue de l’autonomie du droit coopératif, qui impliquerait de détacher la coopérative du droit des sociétés (en créant une nouvelle personne morale, la coopérative, qui ne serait donc ni une société, ni une association). On pourra enfin, plus largement, se demander dans quelle mesure les débats actuels sur l’entreprise comme « bien commun » permettent de renouveler la question des statuts juridiques des coopératives.
Comité d’organisation
- Caroline Fayolle (Maîtresse de conférences, Histoire contemporaine, Institut Universitaire de France/Université de Montpellier)
- Etienne Lamarche (Maître de conférences, Histoire du droit et des institutions, Université Paris Nanterre)
- Camille Ternier (Docteure en philosophie politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Avec le soutien du projet ANR JCJC TheoVail « La théorie politique au travail. Reconceptualiser l’exploitation, la démocratie et la justice à travers les écrits réflexifs de travailleurs et de travailleuses » (Science-Po Paris, CEVIPOF)
Informations pratiques
- Lieu : Sciences Po Paris, 1 Place St Thomas d'Aquin, 75007 Paris
- Dates : 12 et 13 décembre 2024
- Prise en charge du transport (France-pays limitrophes), des repas et de l’hébergement sur place par l’organisation du colloque.
Modalités de soumission
Le résumé de la proposition comportera entre 3000 et 5000 signes (espaces compris et bibliographie non-comprise) et devra être envoyé à l’adresse : enjeuxpolitiques.statuts.coop@gmail.com
Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2024
Retour aux auteurs·ices : 10 juillet 2024
Notes
[1] Pour une recension des cas coopératifs les plus édifiants, voir Philippe Frémeaux, La nouvelle alternative ? : Enquête sur l’économie sociale et solidaire, Paris, Les Petits Matins, 2013, 156 p. Voir aussi Simon Cottin-Marx et Baptiste Mylondo, Travailler sans patron, Mettre en pratique l’économie sociale et solidaire, Folio, 2024.
[2] Au sens courant du terme, c’est-à-dire qu’elles s’opposent au capitalisme, que l’on peut définir a minima comme un régime économique où la production est orientée vers le profit en vue de l’accumulation du capital plutôt qu’en vue de la satisfaction des besoins. Les chercheurs·euses et les acteurs·rices de l’Économie Solidaire et Solidaire semblent souvent réticent·e·s à utiliser ce terme, lui préférant ceux de « lucrativité limitée » ou d’ « a-capitalisme » (Simon Cottin-Marx et Matthieu Hély, « Le projet de l’économie sociale et solidaire : fonder une économie acapitaliste : Entretien avec Jean-François Draperi », Mouvements, vol. 81, no 1, 2015, p. 27‑30). On pourrait pourtant estimer que ces termes renvoient à des règles de fonctionnement qui permettent aux coopératives de porter - sur le plan plus global – un projet politique anti-capitaliste. Sur les caractéristiques juridiques de la règle de fonctionnement de l’a-capitalisme, voir David Hiez, Coopératives : Création, organisation, fonctionnement, Édition : édition 2013-2014., Paris, Dalloz-Sirey, 2013, p. 28.
[3] Elizabeth Anderson, « Equality and freedom in the workplace : Recovering republican insights », Social Philosophy and Policy, vol. 31, no 02, 2015, pp. 48‑69 ; Pierre-Yves Néron, « Rethinking the Very Idea of Egalitarian Markets and Corporations : Why Relationships Might Matter More than Distribution », Business Ethics Quarterly, vol. 25, no 1, Janvier 2015, pp. 93‑124 ; Isabelle Ferreras, Firms as Political Entities : Saving Democracy through Economic Bicameralism, Cambridge, United Kingdom New York, NY, Cambridge University Press, 2017, 226 p ; Abraham A. Singer, The Form of the Firm : A Normative Political Theory of the Corporation, Oxford, New York, Oxford University Press, 2019.
[4] Comme le déplore David Hiez (in Sociétés coopératives 2023/2024, Paris, Dalloz, 2023, p. 46‑47). Citons cependant en plus de cet ouvrage les exemples suivants : Lucien Coutant, L’évolution du droit coopératif de ses origines à 1950, Reims, France, Ed. Matot-Braine, 1950 ; le numéro 317 de la RECMA (août 2010) consacré aux débats relatifs à une réforme possible du droit coopératif ; David Hiez, « Le coopérateur ouvrier ou la signification du principe de double qualité dans les Scop », Revue internationale de l’économie sociale : Recma, no 299, 2006, pp. 34‑55 ; Loïc Seeberger, « Historique de l’évolution du droit des coopératives, de ses origines à nos jours », Revue internationale de l’économie sociale : Recma, no 333, 2014 et, bien sûr, les contributions nombreuses de François Espagne, à trouver à l’adresse https://www.les-scop.coop/doctrines.
[5] David Hiez, Eric Lavillunière et Jean-François Draperi, « Economie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat social. Des projets politiques et économiques différents. », in Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire, Éditions Larcier, 2013, pp. 55‑77.
[6] Michel Dreyfus et Patricia Toucas-Truyen (dir.), Les coopérateurs : deux siècles de pratiques coopératives, Paris, Éditions de l’Atelier/GNC, 2005 ; Michel Dreyfus, Histoire de l’économie sociale et solidaire. De la Grande Guerre à nos jours, Rennes, PUR, 2017 ; Olivier Chaïbi, Timothée Duverger et Patricia Toucas-Truyen (eds.), (Re)Penser l’histoire de l’ESS. Approches et historiographie, Éditions Arbre bleu, Nancy, 2024.
[7] Carole Christen, Caroline Fayolle et Samuel Hayat (eds.), S’unir, travailler, résister : Les associations ouvrières au XIXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021.
[8] Comme par exemple la mise en réserve obligatoire d’au moins 15 % de l’excédent net de gestion dans le cas des Scop, ou l’interdiction de la revente de ces dernières à des fins de profit.
[9] Pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige, Xavier Vigna (dir.), L’Utopie au jour le jour. Une histoire des expériences coopératives (XIXe-XXIe siècle), Nancy, Éditions Arbre bleu, 2020.
[10] Bernard Edelman, La Légalisation de la classe ouvrière ? vol. 1. L’Entreprise, Paris, Bourgois, 1978, 253 p.
[11] François Espagne, « Des modèles originels à un modèle original Remémoration de l’histoire du statut et des outils des SCOP », 12 Janvier 2009 ; Pierre Liret, « Loi de 1978 : une étape essentielle de l’histoire des Scop ». Participer, août 2003.
[12] Erik Olin Wright, Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017.
[13] Maxime Quijoux, « « Vous allez trouver une façon d’être dirigeant. » Formation coopérative et résistances ouvrières dans une usine reprise par ses salariés », Politix, n° 126, no 2, 11 Octobre 2019, p. 203 sqq. ; Camille Ternier, Être des travailleurs libres. Le modèle des coopératives de production comme forme institutionnelle d’une économie démocratique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, p. 668 sqq.
[14] Anders Christiansen, « Evaluating Workplace Democracy in Mondragon », UVM Honors College Senior Theses, 1er Janvier 2014.
[15] Carl J. Bellas, Industrial Democracy and the Worker Owned Firm : A Study of Twenty-One Plywood Companies in the Pacific Northwest, New York, Praeger Publishers Inc, 1972 ; John Pencavel, Worker Participation : Lessons from Worker Co-ops of the Pacific Northwest, Russell Sage Foundation, 2002.
[16] Nous pensons ici aux travaux menés de 2015 à 2018 par un groupe de juristes (formé de David Hiez, Chantal Chomel, Patrick Le Berre, Lionel Orsi et Patrick Prud’homme) ayant aboutit à la proposition de « de loi coopérative utopique » (accessible à l’adresse https ://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/46022/1/loi_cooperative_utopique_2018.pdf). Pour une présentation des innovations de cette loi, voir Patrick Prud’homme, « Vers une loi coopérative rénovée ? », op. cit. C’est à cet article que nous empruntons ce terme de « jardinage du droit coopératif » (p. 80) Voir encore Marina Bertrel, « La Scop SAS : une nouvelle opportunité en faveur de l’entrepreneuriat », Revue internationale de l’économie sociale : recma, no 332, 2014, pp. 124‑133.
[17] Jean-François Draperi et Chantal Chomel, « Construire la communauté coopérative à travers le droit », Revue internationale de l économie sociale Recma, N° 352, no 2, 2019, p. 62.
[18] François Espagne, « Les différentes formes de travail associé dans les sociétés coopératives ouvrières de production en Europe », 14 août 1999.