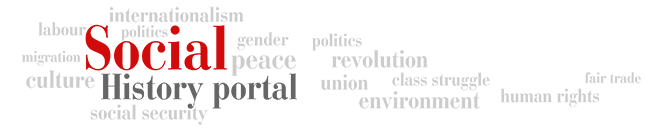Marseille/France
Ce colloque pluridisciplinaire vise à explorer les affinités électives entre anarchisme(s) et écologie(s) depuis le XIXe siècle jusqu’au nos jours. Il vise à combler un angle mort historiographique en interrogeant la richesse des « réflexivités environnementales » anarchistes, des précurseurs comme Kropotkine et Reclus à leurs reconfigurations contemporaines. Le rejet historique par l’anarchisme des structures de pouvoir centralisées et du productivisme de l’« Âge des machines » en fait l’une des traditions politiques les plus en phase avec les impératifs écologiques actuels. En revisitant ces affinités et ces tensions, le colloque offrira de nouvelles clés de lecture pour comprendre les mouvements sociaux qui luttent pour la justice environnementale.
Argumentaire
À une époque où les urgences écologiques sont souvent reléguées au second plan par des régimes autoritaires aux tendances écocidaires — voire réinterprétées au prisme d’une rhétorique fascisante — ce colloque international et pluridisciplinaire propose de revisiter les relations historiques et contemporaines entre anarchisme(s) et écologie(s).
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’anarchisme semble s’être imposé comme l’une des traditions politiques les plus en affinité avec les enjeux écologiques actuels. Son rejet des structures de pouvoir centralisées, sa vision décentralisatrice de l’organisation socio-économique et son approche préfigurative ont nourri cette réputation (Toro, 2021 ; Grillet, 2026). Mais bien en amont, dès la fin du XIXe siècle, des penseurs comme Pierre Kropotkine ou Élisée Reclus, ainsi que les expériences communautaires des milieux libres, ont esquissé des formes précoces d’écologie politique (Linse, 1986, Gould, 1988, Maitron, 1992 ; Masjuan, 2000). À contre-courant de l’industrialisme dominant de « l’âge des machines », l’anarchisme s’est ainsi différencié tant du libéralisme que d’autres variantes du socialisme, en proposant une modernité alternative, portée par des imaginaires romantiques et des pratiques enracinées dans des cultures paysannes et artisanales (Probst, 2024). Ces héritages libertaires semblent inspirer ou imprégner, souvent de façon implicite et diffuse, certaines luttes écologistes, des années 1960 à aujourd’hui.
Ce colloque transdisciplinaire vise à explorer les affinités électives entre anarchisme(s) et écologie(s), en interrogeant les contextes socio-intellectuels ayant permis leur articulation, de leurs prémices au XIXe siècle jusqu’à leurs reconfigurations contemporaines. Nous porterons une attention particulière à la diversité des courants écologistes anarchistes ayant coexisté, ou coexistant encore — tels que l’écologie sociale, le primitivisme, ou le biorégionalisme —, à leurs ancrages scientifiques et militants, ainsi qu’à leurs relectures récentes dans des champs de lutte variés : antinucléaire, féministe, animaliste, antispéciste, décolonial, etc. (Zerzan, 1994 ; Sale, 2000 ; Bookchin, 2019).
L’anarchisme, mouvement hétérogène et souvent conflictuel, difficile à circonscrire du fait de son faible degré de centralisation, sera ici abordé à partir de deux critères principaux : la densité des réseaux et sociabilités militants et intellectuels qui le composent (Bantman et Altena, 2015), et la nature des pratiques sociales qui le caractérisent comme les grèves, milieux libres, pédagogie libertaire, syndicalisme, mutuellisme (Manfredonia, 2007). Loin de se limiter à son « Âge d’or » européen (1871–1914), l’anarchisme prend des formes multiples selon les périodes (communalisme, squats, ZAD) et les contextes géographiques (anarchismes non européens et non occidentaux), et s’hybride fréquemment avec d’autres courants critiques (féminismes, anticolonialismes, primitivismes). Nous privilégierons donc les contributions portant sur des auteurs ou expériences se réclamant explicitement du mouvement anarchiste.
Afin d’éviter toute lecture anachronique, l’écologie sera ici entendue dans un sens large, mais toujours inscrit historiquement, au-delà de sa définition actuelle centrée sur le dérèglement climatique ou les limites planétaires. Dès le XIXe siècle, des préoccupations environnementales comme la santé ouvrière, la pollution de l’air et des sols, la déforestation, la protection des paysages ou le machinisme traversent les mouvements sociaux et investissent certains milieux socialistes (Audier, 2017 ; Lowy et Sayre, 2020). Nous proposons d’interroger, dans cette perspective, les « réflexivités environnementales » entendues comme « les manières complexes, historiquement situées et souvent éloignées des nôtres, de penser les conséquences de l’agir humain sur l’environnement » (Fressoz et Locher, 2010).
Le colloque, résolument transdisciplinaire et transhistorique, se veut être un espace de convergence pour des contributions issues de champs variés — histoire, science politique, sociologie, histoire de l’art, anthropologie, géographie, philosophie, entre autres — autour du dialogue entre anarchisme(s) et écologie(s). Les interventions pourront porter aussi bien sur la période dite de l’« âge d’or » de l’anarchisme (1871–1914) et l’entre-deux-guerres, que sur l’émergence et l’essor de l’écologie politique (années 1960–1990), ou encore sur ses reconfigurations contemporaines (des années 1990 à aujourd’hui).
C’est à la lumière de cette compréhension élargie que les contributions pourront s’articuler autour de quatre grands axes de réflexion, visant à mieux saisir, depuis une perspective écologique, les pratiques et les pensées anarchistes, y compris lorsqu’elles embrassent des idéaux industrialistes ou technophiles.
1. Nature(s), sciences et savoirs populaires
L’anarchisme, tel qu’il émerge au XIXe siècle, se développe dans un contexte scientifique en pleine mutation, où la “nature” devient progressivement un objet de science et d’intervention. Tandis que l’écologie naissante propose une nouvelle approche du vivant, et que se développent parallèlement des mobilisations environnementales portées par des savoirs populaires ou vernaculaires (Ambroise-Rendu et al., 2021), certains savants alertent déjà sur les dégradations environnementales — déforestation, épuisement des sols. Plutôt que de reproduire une stricte opposition nature/culture, de nouvelles manières de penser le politique et le social s’articulent alors à la question du milieu naturel, notamment au sein des courants socialistes et anarchistes. Ces derniers, à l’instar de Reclus ou Kropotkine, développent des visions organicistes ou naturalistes de la société, valorisant l’épanouissement de l’individu dans son environnement (Taylan, 2018).
Au XXe siècle, les alertes écologiques et les luttes environnementales s’entrelacent de plus en plus étroitement avec la production et la diffusion de savoirs scientifiques et populaires, accentuant les convergences entre pensées anarchistes et écologies politiques — comme en témoigne, entre autres, l’influence de Murray Bookchin dès les années 1960.
Une attention particulière pourra être portée sur la dimension artistique de l’anarchisme, envisagée comme un espace d’expression écopolitique. Art social, poésie, chansons, peinture etc. pourront être étudiés pour mettre en lumière la manière dont ces formes artistiques articulent idéaux libertaires et préoccupations environnementales, en proposant une critique sensible de l’industrialisation et une autre relation au monde naturel.
i. Les théories anarchistes, historiques et contemporaines, dessinent-elles un nouveau régime ontologique ? Comment articulent-elles la “nature” avec leur projet politique d’émancipation ? Quels débats ou controverses suscitent-elles au sein des courants anarchistes ?
ii. Comment les anarchistes intègrent-iels, politisent-iels et diffusent-iels (ou non) les alertes environnementales scientifiques ou portées par des savoirs populaires ?
iii. Comment les écologistes reçoivent-iels et s’approprient-iels les théories anarchistes de la nature, notamment à travers la valorisation conjointe des savoirs scientifiques et des savoirs ou pratiques vernaculaires ?
2. L’économie politique et la technique chez les anarchistes
Né au cœur du siècle industriel, l’anarchisme a très tôt été confronté à la question du progrès technique. Si certains courants ont vu dans les machines et les innovations un levier possible d’émancipation et d’égalitarisation des conditions socioéconomiques, d’autres ont formulé des critiques radicales de la technicisation du monde. Chez William Morris et Edward Carpenter cette critique est notamment abordée d’un point de vue esthétique et résonne parfois avec celles contemporaines du productivisme (Jarrige, 2014). Cet axe entend explorer ces tensions internes à l’anarchisme autour de son économie politique, en interrogeant la diversité des positions face à l’industrialisation, au machinisme, au commerce international, aux infrastructures énergétiques, à la marchandisation du vivant ou à l’organisation des territoires (ville/campagne, centralisation/décentralisation). Cela engage à repenser la place de la technique dans tout projet politique libertaire : peut-on penser une technologie anarchiste ? Quelles formes de techniques et de productions sont compatibles avec une société égalitaire et écologiquement soutenable ?
L’attention sera portée aux pratiques concrètes (consommation, coopératives, autogestion, autoproduction), à la culture matérielle, et aux ancrages socioprofessionnels des militant·es (ouvrier·es, paysan·nes, ingénieur·es, artisan·es, etc.), afin de mieux comprendre comment les rapports à la nature, à la technique et à l’économie se traduisent dans leurs théories, modes de vie et d’organisation. Cet axe invite donc à réinterroger la manière dont les anarchistes problématisent la notion de besoins “naturels” et “artificiels”.
i. Quelles sont les évolutions de leurs conceptions du progrès technique ou du machinisme ? Comment peut-on imaginer le développement de technologies, machines ou infrastructures économiques compatibles avec l’anarchisme ?
ii. Au-delà des procès de production, quels sont les modes ou pratiques de consommation promus par les anarchistes ? Que consomment les anarchistes concrètement ? Et comment saisir leurs tentatives de redéfinir, notamment, la notion de besoin ?
iii. Comment les expériences professionnelles (paysan, artisan, ouvrier, ingénieur, artiste…) et/ou les propriétés socioprofessionnelles anarchistes influencent-elles les modes de politisation de la nature et leurs pratiques économiques ?
3. Théories du changement social et pratiques des mouvements sociaux
Théoricien·nes et militant·es anarchistes et écologistes développent des stratégies politiques variées en vue d’une transformation sociale et écologique radicale. Ces stratégies donnent lieu à de nombreux débats, notamment sur l’attitude à adopter face à l’État et aux institutions, sur le recours à la violence, ou encore sur les figures sociales (paysans, syndicalistes, etc.) perçues comme moteurs du changement (Manfredonia, 2007 ; Bookchin, 2019).
Cet axe propose également de s'intéresser à la dimension préfigurative des pratiques anarchistes et écologistes : dans une critique du mythe du Grand Soir, ces mouvements cherchent à incarner dès le présent les formes de vie qu’ils souhaitent voir advenir. Cela passe par des efforts d'(auto-)éducation populaire, par l’expérimentation de modes de vie alternatifs, mais aussi par des pratiques de réforme de soi — souvent corporelles — telles que l’hygiénisme, l’ascétisme, la grève des ventres ou encore les formes d’autodiscipline quotidiennes (Baubérot, 2014 ; Coste, 2023).
Enfin, cet axe entend explorer les formes de cohabitation, de tensions ou de synergies entre militant·es anarchistes et écologistes dans les espaces de lutte communs. Il s’agira notamment d’interroger la circulation des pratiques, les transferts idéologiques ou les critiques mutuelles qui peuvent émerger au sein de ces convergences.
i. Quelles sont les stratégies (parfois concurrentes) qu’élaborent anarchistes et écologistes pour changer et écologiser le monde social ? Quels types de mobilisations sont privilégiés ? Quel·les sont les acteur·ices ou sujets moteurs du changement social (paysan·nes, ingénieur·es…) ? Quel rôle peut y jouer la violence politique ? Ces débats autour des stratégies politiques de mobilisation suscitent-ils des controverses avec les stratégies écologistes ?
ii. Quel est le statut accordé aux pratiques préfiguratives au sein de ces mobilisations (éducation populaire, professionnelle, réforme de soi, ascétisme, végétarisme...) ?
iii. Comment les militant·es anarchistes participent-iels, critiquent-iels et marquent-iels les mobilisations écologistes d’hier et d’aujourd’hui (Rio Tinto, Larzac, Notre-Dame-Des-Landes…) ?
4. Convergences et divergences : circulations, hybridations et débats
Si les écologistes et les anarchistes partagent de nombreuses références historiques, théoriques, pratiques militantes et modalités d’action, ces deux mouvements restent parfois traversés par des divergences marquées. Les espaces d’hybridation – qu’ils soient historiques ou contemporains – ne manquent pourtant pas (antimilitarisme, luttes antinucléaires, antispécisme, lutte contre les grands projets inutiles, etc.), mais ne suffisent pas à effacer les tensions persistantes autour de questions centrales : la place des pensées du vivant, le rôle de la lutte des classes ou la question de l’échelle (localisme/internationalisme). Cet axe souhaite ainsi étudier ces hybridations et tensions.
De plus, cette partie veut creuser et approfondir deux zones de tension majeures qui suscitent aujourd’hui des reconfigurations ou des controverses dans les milieux anarchistes comme écologistes : les rapports de genre et les questions raciales.
L’essor des pensées écoféministes et éco-queers renouvelle profondément la critique de la naturalisation des rapports sociaux, et entre en résonance – parfois de manière conflictuelle – avec certaines traditions anarchistes. Mais déjà, au tournant du XXe siècle, des figures comme Edward Carpenter défendaient une conception libertaire de l’amour libre, de l’égalité entre les sexes et une dépathologisation de l’homosexualité (Alicia, 2019 ; Cleminson, 2019 ; Lecerf Maulpoix, 2021). Aujourd’hui, écoféministes et éco-queers interrogent à nouveaux frais les rapports au corps, au désir, à la subsistance, au travail reproductif et à l’écologie du soin (Pruvost, 2021 ; Rimlinger, 2024).
De manière complémentaire, il s’agira aussi d’interroger la façon dont les mouvements anarchistes et écologistes s’attaquent – ou non – à la matrice coloniale et raciale du capitalisme fossile (Dupuis-Déri et Pillet, 2019). Ce dernier est à l’origine d’une longue histoire de dépossession coloniale et d’exploitation des ressources naturelles (Moore, 2020). Pourtant, ces dimensions ont longtemps constitué des angles morts dans nombre de traditions militantes (Merchant, 2003 ; Ferdinand, 2019). Le colloque propose ainsi de réfléchir aux notions contemporaines d’écologie décoloniale, de justice environnementale, de dette écologique, de colonialisme vert, de malthusianisme, de formes de localisme (bio)déterministe ou encore à la question des réfugié·es climatiques.
i. Comment procèdent les circulations militantes ou théoriques entre anarchisme et écologie politique ? Par quels biais se diffusent et s’hybrident les théories ou pratiques anarchistes au sein des mouvements écologistes, et inversement ?
ii. Comment les enjeux de genre et d’identités sexuelles, notamment autour de la naturalisation de l’ordre sexuel, de la place du corps ou des modes de subsistance, sont-ils intégrés (ou non) dans les espaces anarchistes et écologistes ? Quels sont les débats qui en émergent ?
iii. Comment les enjeux de race et de colonialité, comme ceux de la justice environnementale globale, les réfugiés ou la dette écologiquement inégale, traversent-ils les débats militants anarchistes et écologistes ?
Modalités de soumission
Nous sollicitons les contributions de la communauté scientifique et militante. Aussi, une attention particulière sera accordée aux travaux des doctorant·es et jeunes docteur·es, tout en ouvrant volontiers l'appel aux étudiant·es en master.
Les propositions de communication devront indiquer :
- Un titre,
- l’axe de l’appel dans lequel elles s’inscrivent,
- la discipline ou la forme d’engagement dans laquelle elles s’inscrivent,
- cinq mots clefs,
- une bibliographie.
- ne pas excéder 500 mots de résumé, incluant une présentation des matériaux, de la méthodologie, un positionnement par rapport à la littérature, une problématique et des axes.
Elles devront être envoyées au format .doc ou .docx à l’adresse ecologiesanarchistes@proton.me avant le 30 mars 2026 à minuit.
Calendrier
- 30 mars 2026 : Date limite d’envoi des propositions de communication
- Juin 2026 : Notification d’acceptation ou de refus des propositions
- 5-6 novembre 2026 : Tenue du colloque
Lieu du colloque
Beaux-Arts de Marseille, Campus Luminy
Comité scientifique
- Emeline Fourment (Université de Rouen-Normandie/CUREJ)
- Florian Gaité (École supérieure d'art d'Aix-en-Provence/ACTE)
- Emilie Hache (Université Paris-Nanterre/Sophiapol)
- Samuel Hayat (CNRS/Cevipof)
- François Jarrige (Université Bourgogne-Europe/LIR3S)
- Anna Trespeuch-Berthelot (Université Caen Normandie/HisTéMé)
- Alexis Vrignon (Université d’Orléans/POLEN)
Comité d’organisation
- Thomas Coste (Université d’Évry/IDHES)
- Léo Grillet (Sciences Po/CEE)
- Cy Lecerf Maulpoix (EHESS/CEMS)
Bibliographie
Ambroise-Rendu Anne-Claude, Hagimont Steve, Mathis Charles-François, Vrignon Alexis, Une histoire des luttes pour l’environnement, Paris, Éditions textuel, 2021.
Ardillo José, La Liberté dans un monde fragile. Écologie et pensée libertaire, Paris, L'Échappée, 2018.
Audier Serge, La société écologique et ses ennemis, Paris, La Découverte, 2017.
Bantman Constance, Altina Bert, Reassessing the Transnational Turn: Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies, Oakland, PM Press, 2015.
Baubérot Arnaud, « Aux sources de l’écologisme anarchiste Louis Rimbault et les communautés végétaliennes en France dans la première moitié du XXe siècle », Le Mouvement Social, 2014, no 246, p. 63‑74.
Beaudet Céline, Les milieux libres : vivre en anarchiste à la Belle époque en France, Saint-Georges-d’Oléron, Les éditions libertaires, 2011.
Berlan Aurélien, Terre et liberté : la quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, Saint-Michel-de-Vax, Éditions La lenteur, 2021.
Biehl Janet, The Politics of Social Ecology: Libertarian Municipalism, Montréal, Black Rose Books, 1998.
Bonneuil Christophe et Fressoz Jean-Baptiste, L'événement anthropocène : la Terre, l'histoire et nous, Paris, Éditions Points, 2016.
Bookchin Murray, Une société à refaire : vers une écologie de la liberté, Montréal, Écosociété, 2011.
Bookchin Murray, Notre environnement synthétique : la naissance de l’écologie politique, Lyon, Atelier de création libertaire, 2017.
Bookchin Murray, Changer sa vie sans changer le monde : l’anarchisme contemporain entre émancipation individuelle et révolution sociale, Agone, Marseille, 2019.
Carpenter Edward, Des jours et des rêves, Paris, Le Pommier, 2025.
Carroll Alicia, New woman ecologies: from arts and crafts to the Great War and beyond, Charlottesville, University of Virginia Press, 2019.
Carter Alan, A Radical Green Political Theory, New York, Routledge, 1999.
Clark John P., Martin Camille (eds), Anarchy, Geography and Modernity: The Radical Social Thought of Élisée Reclus, Lanham, Lexington Books, 2004.
Cleminson Richard, Anarchism and eugenics: an unlikely convergence, 1890-1940, Manchester, Manchester University Press, 2019.
Coste Thomas, « Vivre en Robinson. Georges Butaud et Sophie Zaïkowska, anarchistes et végétaliens (1898-1929) », 2023, Mil neuf cent, no 41, p. 95‑116.
Dupuis-Déri Francis et Pillet Benjamin, L'anarcho-indigénisme, Montréal, Lux, 2019.
Ferdinand Malcom, Une écologie décoloniale: Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Paris, Le Seuil, 2019.
Fourment Emeline, Théories en action : appropriations des théories féministes en milieu libertaire à Berlin et Montréal, Doctorat réalisé à Sciences Po Paris, soutenu en 2021.
Fressoz Jean-Baptiste et Locher Fabien Locher, « Le climat fragile de la modernité », La Vie des Idées, en ligne en 2010.
Gould Peter C., Early green politics: back to nature, back to the land, and socialism in Britain, 1880-1900, Brighton, Harvester press & St. Martin's press, 1988.
Grillet Léo « (Over)Greening Anarchism. Toward An Environmental and Contextualist History of Anarchist Ideology », in Faure Juliette, Humphreys Matthew, Laylock David, Handbook of Ideology Analysis, New York, Routledge, à paraître en 2026.
Jakobsen Ove Daniel, Anarchism and Ecological Economics. A Transformative Approach to a Sustainable Future, Londres, Routledge, 2019.
Jarrige François, Technocritiques: Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014.
Kossof Gideon, White Damian F., “Anarchism, Libertarianism and Environmentalism: Anti-Authoritarian Thought and the Search for Self-Organizing Societies”, dans Pretty Jules et al. (ed.), The SAGE handbook of environment and society, 2007, p. 50-65.
Lecerf Maulpoix Cy, Écologies déviantes. Voyage en terres queers, Paris, Cambourakis, 2021.
Linse Ulrich, Ökopax und Anarchie: eine Geschichte der ökologischen Bewegungen in Deutschland, Orig.-Ausg., München, Dt. Taschenbuch-Verl, 1986.
Lowy Michael sayre Robert, Romantic Anti-capitalism and Nature: The Enchanted Garden, Londres, Routledge, 2020.
Maitron Jean, Le mouvement anarchiste en France, Paris, Gallimard, 1992.
Marshall Peter, Nature's Web: An Exploration of Ecological Thinking, Londres, Simon and Schuster, 1992.
Manfredonia Gaetano, Anarchisme et changement social, Lyon, Atelier de création libertaire, 2007.
Masjuan Eduard, La ecología humana en el anarquismo ibérico, Barcelone, Icaria, 2000.
Merchant Carolyn, « Shades of Darkness: Race and Environmental History », Environmental History, Vol. 8, No. 3, 2003, p. 380-394.
Morris Brian, «Anarchism and Environmental Philosophy», dans Jun Nathan (ed.). Brill's Companion to Anarchism and Philosophy, Leiden, Brill, 2017, p. 369–400.
Moore Jason W., Le capitalisme dans la toile de la vie: écologie et accumulation du capital, Toulouse, L’Asymétrie, 2020.
Peirera Irène, « Pierre Kropotkine et Élisée Reclus, aux sources des théories anarcho-communistes de la nature » dans Bourdeau Vincent et Macé Arnaud, La Nature du socialisme, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, p. 393-407.
Pelletier Philippe, Noir & vert: anarchie et écologie, une histoire croisée, Paris, Le Cavalier Bleu, 2021.
Price Andy, «Green anarchism», dans Levy Carl, and Adams Matthew (eds.), The Palgrave Handbook of Anarchism, Londres, Palgrave, 2019, p. 281-291.
Probst Milo, Anarchistische Ökologien. Eine Umweltgeschichte der Emanzipation, Berlin, Matthes & Seitz Berlin, 2024.
Pruvost Geneviève, Quotidien politique : Féminisme, écologie, subsistance, Paris, La Découverte, 2021.
Purchase Graham, Anarchism and Ecology, Montréal, Black Rose Books, 1993.
Rimlinger Constance, Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, Paris, Presses universitaires de France, 2024.
Ryley Peter, Making Another World Possible. Anarchism, Anti-Capitalism and Ecology in Late 19th and Early 20th Century Britain, New York, Bloomsbury, 2013.
Sale Kirkpatrick, Dwellers in the Land: The Bioregional Vision, London, University of Georgia Press, 2000.
Sauvêtre Pierre, Murray Bookchin ou L’objectif communocène : écologie sociale et libération planétaire, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2024.
Siegrist Pascale, «Historicizing Anarchist Geography. Six Issues for Debate from a Historian’s ‘Point of View’», in Della torre Gerónimo Barrera, Ferretti Federico, Ince Anthony and Toro Francisco (eds.), Historical Geographies of Anarchism. Early Critical Geographers and Present-Day Scientific Challenges, Routledge, Londres, 2017, 129-150.
Springer Simon, The Anarchists Roots of Geography: Towards Spatial Emancipation, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2016.
Taylan Ferhat, Mésopolitique. Connaître, théoriser et gouverner les milieux de vie (1750-1900), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018.
Toro Francisco, «Stateless Environmentalism: The Criticism of State by Eco-Anarchist Perspectives», ACME: An International Journal for Critical Geographies, 20(2), 2021, 189–205.
Verdier Margot, Le commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Vulaines-sur-Seine, Éditions du croquant, 2021.
Villalba Bruno, L’écologie politique en France, Paris, La Découverte, 2022.
Vrignon Alexis, La naissance de l’écologie politique en France : une nébuleuse au cœur des années 68, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
Williams, Dana M. (2009), «Red vs. green: regional variation of anarchist ideology in the United States», Journal of Political Ideologies, 14/2, 2009, p. 189–210.
Zerzan John, Future Primitive and others Essays, New York, Autonomedia, 1994.
Lieux
- Campus Luminy - Beaux-Arts de Marseille
Marseille, France (13)
Format de l'événement
Événement hybride sur site et en ligne
Dates
Fichiers attachés
Mots-clés
- anarchisme, écologie, pluridisciplinaire
URLS de référence
Contact
- Thomas Coste
courriel : thomas [dot] coste [at] universite-paris-saclay [dot] fr