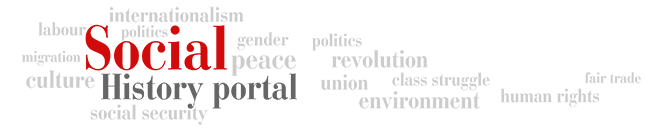À l’occasion de la réunion de la Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges et le Mobilier national sous l’appellation Manufactures nationales – Mobilier national & Sèvres le 1er janvier 2025, le Groupe de Recherche en Histoire de l’Art Moderne (GRHAM) a décidé d’orienter son colloque annuel sur les manufactures d’art des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette recomposition institutionnelle invite à relire l’histoire des manufactures, non comme un âge d’or figé, mais comme une histoire mouvante, marquée par des ruptures internes et des redéfinitions constantes des liens entre État, artistes et ouvriers.
Inserat
Colloque international du GRHAM
Date et lieu de l’événement : les 11 et 12 juin 2026, salle Jullian, Galerie Colbert (Université Paris 1 / INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris
Argumentaire
Si une partie de l’historiographie s’est intéressée au rôle de Jean-Baptiste Colbert dans le développement des manufactures à partir des années 1660 (Minard, 1998), la notion de manufacture, plurielle et évolutive, doit être entendue dans son acception large. Elle ne se résume pas à Colbert ni même aux initiatives royales, comme la création de la manufacture de tapisseries de la Savonnerie en 1628 par Louis XIII. Dès le début du XVIIe siècle, la notion de manufacture renvoie à la fois à un lieu rassemblant des ouvriers spécialisés, à une structure économique et à un espace de production (Bély, 1996). Certaines, comme les Gobelins, Saint-Gobain ou Sèvres, sont établies ou contrôlées par l’État ; d’autres bénéficient simplement de privilèges. Si les années 1790 correspondent à une rupture majeure dans l’organisation du travail corporatif (loi Le Chapelier et décret d’Allarde, 1791) aussi bien que dans le rapport aux académies (1793), l’activité manufacturière se poursuit et s’adapte au nouveau pouvoir en place. À l’échelle européenne, les termes Manufaktur, fabbrica ou fábrica témoignent d’une diversité de modèles, de pratiques et d’organisations qui invite à une approche comparée, oscillant entre artisanat, proto-industrie et enjeux politiques. L’un des enjeux majeurs de ce colloque réside donc dans l’étude comparée, mais non hiérarchisée, des différentes manufactures en France et en Europe. Il s’agira d’examiner conjointement les œuvres, les motifs et les dispositifs de travail, à partir des conditions matérielles et techniques de fabrication ainsi que des modes de collaboration entre artistes et artisans dans l’espace européen.
Comprendre la manufacture au XVIIe et au XVIIIe siècle, c’est étudier les liens – parfois harmonieux, parfois conflictuels – entre arts mécaniques et arts libéraux, entre art et artisanat, entre la figure de l’artiste et celle de l’ouvrier. Du Dictionnaire de Furetière (1690) à l’Encyclopédie méthodique (1784), la manufacture apparaît indissociable du travail de la main et de la fabrication d’objets à la fonction utilitaire, dont certains relèvent d’un véritable travail d’artiste. Il sera particulièrement intéressant, dans le cadre de ce colloque, d’interroger ces glissements entre objet d’art et objet d’usage. Par ailleurs, au sein même de ces établissements, s’opère une distinction entre les différents acteurs de la production. Celle-ci se renforce à partir du Grand Siècle, notamment avec l’essor des académies (Michel, 2012 ; Guilois, 2018 ; Guichard, 2002-2003), qui institutionnalisent la séparation entre l’artisan, détenteur d’un savoir-faire mécanique, et l’artiste, valorisé pour sa créativité intellectuelle et son appartenance aux arts libéraux. Cette hiérarchisation des statuts éclaire d’un jour nouveau l’organisation du travail manufacturier et les enjeux sociaux, artistiques et économiques qui le sous-tendent.
Les recherches et expositions récentes ont montré combien les manufactures constituent des lieux de création à plusieurs mains. Qu’il s’agisse de tapisserie – Mortlake, Gobelins, Beauvais – ou de céramique – Sèvres, Meissen, Chantilly ou Doccia –, les études monographiques ont montré combien les artistes ont nourri, orienté ou transformé les pratiques manufacturières. Les travaux consacrés à Le Brun, Coypel, De Troy, ou encore Oudry, tout comme les expositions Poussin et Moïse (Mobilier national 2011), La fabrique de l’extravagance (Chantilly, 2021), ou L’Amour en scène ! (Tours, 2022), ont mis en lumière la manière dont les artistes participent à l’invention des modèles, à l’adaptation aux contraintes techniques ou à la construction d’esthétiques spécifiques à chaque établissement. En dépassant le cadre monographique pour interroger les modalités de la collaboration entre les artistes et les manufactures – continuités, ajustements, discordance, réappropriations, copies – ce colloque permettra ainsi d’éclairer la manière dont se forge une œuvre à plusieurs mains et de mieux comprendre le rôle des manufactures dans la circulation des styles, des modèles et des savoir-faire à l’époque moderne.
Dans cette perspective, l’étude des manufactures ne peut désormais se passer d’une approche élargie aux savoir-faire, aux matériaux et aux innovations techniques. Les manufactures sont des lieux d’expérimentation, où s’élaborent de nouvelles pâtes, de nouveaux émaux, des perfectionnements de tissages ou de teintures, au croisement des savoir-faire empiriques et des savoirs savants, comme l’ont montré les travaux sur la porcelaine européenne ou les études physico-chimiques récentes entreprises autour de Meissen par exemple. Le material turn (Roche, 1997 ; Guichard, 2015 ; Nègre, 2016), a rapproché l’histoire de l’art de l’histoire des techniques et de l’économie, révélant l’importance des transferts : migrations d’ouvriers spécialisés, échanges entre provinces et capitale, circulations européennes — de Venise à Paris, de Rouen à Saint-Cloud — et même mondiales, comme l’ont montré les travaux sur les indiennes et les toiles imprimées. Dans le sillage des réflexions de Liliane Hilaire-Pérez, Fabien Simon ou Marie Thébaud-Sorger (2018), les techniques ne sont plus envisagées comme de simples « sciences appliquées », mais comme des savoirs à part entière. La notion de « technique ouverte » (Foray & Hilaire-Perez, 2006), forgée pour souligner l’importance des dispositifs d’échange et de publicité des savoirs, invite à considérer les manufactures comme des nœuds de réseaux où s’articulent pratiques d’atelier, politiques d’État et dynamiques de marché. Ce colloque étudiera la nature de ces transmissions : imitation, adaptation, innovation ou appropriation.
La question du motif constitue un autre champ d’exploration fondamental pour comprendre les dynamiques internes des manufactures aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Étudier le “parcours” des motifs — depuis leur invention jusqu’à leur adaptation technique — permet d’aborder le rapport étroit entre processus créatif et processus productif, et de mesurer la popularité des formes d’une manufacture à l’autre ou d’un matériau à un autre. Les toiles de Jouy ont révélé le rôle crucial des dessinateurs comme Lagrenée ou Huet ; les recherches récentes sur le design textile (Gril-Mariotte, 2023) rappellent l’ancienne tradition de collaboration entre artistes académiques et ateliers manufacturiers. L’étude de la diffusion des modèles — qu’il s’agisse de l’importation d’un “goût français” à Meissen, des adaptations mutuelles entre Sèvres et Wedgwood ou encore du rôle d’intermédiaires comme Nicodème Tessin le Jeune dans la diffusion des formes gobelines à l’étranger – invite à interroger l’existence éventuelle de motifs propres à certains types de production, ainsi que les modalités de leur déplacement, reprise ou transformation. Ce colloque propose ainsi d’examiner comment les motifs voyagent, se recomposent et se réinventent au gré des matériaux, des ateliers et des circulations humaines, et d’évaluer si les artistes travaillant pour plusieurs manufactures adaptent leurs méthodes ou transportent un même vocabulaire formel d’un support à l’autre.
L’approche sociologique des manufactures royales, qui a concentré la majorité des études sur le sujet, révèle un milieu professionnel structuré, mais très contrasté selon les institutions. Loin du système corporatif traditionnel (Bonnet 2015 & 2017), les manufactures royales forment des espaces de production centralisés, hiérarchisés, où se côtoient ouvriers, artistes et personnels administratifs sous l’autorité d’un directeur nommé par la Couronne. Les recherches d’Isabelle Gensollen éclairent particulièrement cette organisation : rôle déterminant du directeur général, contrôle étroit des finances et des stratégies artistiques, place politique des manufactures comme instruments de prestige monarchique. Parallèlement, d’autres études — de Maës à Coural — esquissent les réalités sociales internes, depuis la vie dans l’enclos des Gobelins jusqu’aux mobilités d’ouvriers ou de familles entières, comme les Masfayon à Aubusson, révélant des logiques de réseaux, de lignées et de spécialisation technique. L’ensemble de ces travaux dessine une sociologie complexe et plurielle, où la manufacture apparaît non seulement comme un lieu de production, mais aussi comme un cadre de vie, un espace hiérarchisé et un outil politique au service de l’État monarchique. Dans une logique comparatiste, ce colloque aura aussi pour objectif de faire le point sur les différentes modalités manufacturières en France et en Europe, entre le début du XVIIe siècle et la période révolutionnaire.
Les propositions de communication devront donc s’articuler autour des trois axes suivants :
Axe 1 : Vivre la manufacture : organisations, métiers et économies
Ce premier axe propose d’explorer la vie au sein des manufactures, en mettant l’accent sur les dimensions sociales, économiques et organisationnelles. Il s’agit d’analyser la diversité des métiers et la division des tâches, la formation des ouvriers et des apprentis, ainsi que les interactions entre artistes et artisans, souvent hiérarchisées, mais toujours interdépendantes. L’étude des administrations et des modèles économiques, qu’il s’agisse de manufactures royales, privilégiées ou privées, permet de comprendre le rôle de l’État et des directeurs dans la structuration de la production, la circulation des modèles et la mise en marché des objets.
Axe 2 : Fabriquer, copier, traduire : les processus créatifs en manufacture
Ce second axe s’intéresse aux pratiques de production et aux savoir-faire développés au sein des manufactures. Il propose d’étudier les gestes techniques, les matériaux employés et les innovations mises en œuvre pour répondre aux exigences artistiques et aux contraintes matérielles. Les motifs, leur reproduction, adaptation ou traduction d’un support à un autre, ainsi que la production multiple ou la copie, permettent de saisir les interactions entre création et fabrication. L’intermédialité — le passage d’un dessin à la tapisserie, d’une estampe à un tissu, d’un modèle à la porcelaine — ouvre un riche champ d’investigation sur la circulation interne des formes et sur l’invention partagée. Les contributions pourront également questionner comment l’expérimentation technique et la manipulation des matériaux participent à la construction des esthétiques manufacturières. Enfin, la question des droits sur les motifs et inventions ouvre un champ de réflexion sur la propriété intellectuelle et la reconnaissance des créateurs dans ces espaces de travail collectif.
Axe 3 : Fabriques en réseau : mobilités, partenariats et inspirations
Ce dernier axe explore les interactions entre manufactures et la façon dont les acteurs — artistes, artisans et intermédiaires tels que les marchands — façonnent la production et la diffusion des formes et des savoir-faire. Il s’agit d’analyser les mobilités horizontales et verticales des artistes et artisans, au sein d’une même manufacture ou entre différents ateliers, ainsi que le rôle des marchands dans la création, l’adaptation et la transmission des modèles. Les contributions pourront interroger comment ces interactions structurent les pratiques manufacturières, influencent les choix stylistiques et techniques, et participent à l’émergence de réseaux artistiques et productifs à l’échelle nationale et européenne. Les modalités de la commercialisation conjointe par les manufactures et les marchands seront analysées.
Les propositions pourront s’inscrire dans l’un ou plusieurs d’entre eux, les axes restent indicatifs.
Le colloque se concentrera sur les manufactures d’art, d’armes et de certains textiles (indiennes, toile de Jouy), en France et en Europe, en privilégiant l’approche des productions, des pratiques et des relations entre artistes et artisans, de la traduction d’un médium à un autre.
Sont ainsi exclues les industries non artistiques, telles que les manufactures de tabac ou autres productions utilitaires comme les manufactures de draps par exemple. De même, la simple étude des échanges entre Paris et la province ou entre la France et l’étranger, largement traitée par l’historiographie traditionnelle, ne constitue pas le cœur de cette rencontre.
L’accent sera mis sur les dynamiques internes des manufactures, sur la circulation horizontale et verticale des artistes et artisans, sur les transferts techniques et iconographiques entre matériaux et supports, ainsi que sur le rôle des marchands dans la création et la diffusion des formes. L’objectif est de dépasser les approches institutionnelles classiques pour proposer une lecture « par le bas » des pratiques manufacturières, tout en permettant des comparaisons entre différentes traditions nationales et européennes et entre manufactures royales ou privées.
Propositions de communication
Les propositions de communication, individuelles ou collaboratives, en français ou en anglais, d’environ 300 mots, pourront prendre la forme de propos généraux ou d’études de cas. Les candidats sont priés de joindre un curriculum vitae.
Date limite d’envoi des propositions : 29 mars 2026.
Envoi des propositions et contacts : asso.grham@gmail.com
Dates du colloque : 11 et 12 juin 2026
Comité organisateur
Élisa Bérard (doctorante, Sorbonne Université), Maxime Bray (doctorant, Sorbonne Université), Justine Cardoletti (doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Romane de Chastellux (doctorante, Sorbonne Université), Défendin Détard (doctorant, Sorbonne Université), Maxime-Georges Métraux (expert, Galerie H. Duchemin), Maël Tauziède-Espariat (maître de conférences, Université Paris-Nanterre), membres du bureau du Groupe de Recherche en Histoire de l’art moderne (GRHAM).
Bibliographie sélective
ALBIS Antoine d’., « La manufacture de Vincennes-Sèvres à la recherche de la porcelaine dure, 1747-1768 », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 4, 1995, p. 48-63.
ALBIS Antoine d’., « Porcelaine de Sèvres : authentique ? Surdécoration ? Contrefaçon ou encore tout simplement “perruque” ? », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n°15, 2006, p. 50-58.
BALLERI Rita, Modelli della Manifattura Ginori di Doccia: Settecento e gusto antiquario, Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 2014.
BASTIEN Vincent, « L’évolution insolite du “vase Cornet” à Sèvres au XVIIIe siècle », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 28, 2019, p. 52-60.
BENTZ Bruno, « Les faïences de Saint-Cloud : quelques aspects de la production royale », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 4, 1995, p. 36-42.
BENTZ Bruno, « La faïence au service du Roi », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 6, 1997, p. 43-51.
BERTRAND Pascal-François, La peinture tissée : théorie de l’art et tapisseries des Gobelins sous Louis XIV, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
BIANCALANA Alessandro, « La sculpture à Doccia au XVIIIe siècle », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 25, 2016, p. 62-71.
BIERI THOMSON Helen, LANZ Hanspeter, « La manufacture de porcelaine de Zürich, 1763-1790 », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 16, 2007, p. 78-87.
BILLON Anne, La sculpture à la manufacture de Sèvres à la fin du XVIIIe siècle (1770-1800), thèse de doctorat en histoire de l’art, Université Paris IV-Sorbonne, 1999.
BREJON DE LAVERGNEE Arnaud (dir.), Fastes du pouvoir : objets d’exception, XVIIIe-XIXe siècles. Collections du Mobilier national, Paris, Manufactures nationales Gobelins-Beauvais-Savonnerie, 2007.
BREMER-DAVID Charissa, French Tapestries & Textiles in the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 1997.
BURRESSI Mariagiulia, La Manifattura toscana dei Ginori, Doccia 1737-1791, Ospedaletto, Pacini, 1998.
CARNOT François, Musée des Gobelins : les belles tentures de la Manufacture royale des Gobelins, 1662-1792, Paris, Imprimerie Frazier-Soye, 1937.
CARACAUSI Andrea, DAVIS Matthew, MOCARELLI Luca (dir.), Between Regulation and Freedom. Work and Manufactures in European Cities, 14th-18th Centuries, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018.
CAROLA-PERROTTI Angela, Le porcellane dei Borbone di Napoli : Capodimonte e Real Fabbrica Ferdinandea, 1743-1806, Naples, Guida, 1986.
CAYEUX Jean de, « Jean-Baptiste Tandart : peintre et inventeur de décors à Sèvres », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 9, 2000, p. 26-37.
COURAL Jean, Les Gobelins, Beauvais, la Savonnerie, Paris, A. Morancé, 1976.
COURAL Jean, Beauvais : manufacture nationale de tapisserie, Paris, Centre national des arts plastiques, 1992.
DESRANTE Virginie, « Thorvaldsen du marbre au biscuit », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 25, 2016, p. 106-115.
DUPONT Pierre, Stromatourgie ou De l’excellence de la manufacture des tapis dits de Turquie, Paris, Charavay Frères, 1882.
ENNÈS Pierre (dir.), Un défi au goût : 50 ans de création à la Manufacture royale de Sèvres, 1740-1793, Paris, Réunion des musées nationaux, 1997.
FAŸ-HALLÉ Antoinette (dir.), « De quelques statuettes du XVIIIe siècle », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 11, 2002, p. 21-25.
FAŸ-HALLÉ Antoinette (dir.), Les vases de Sèvres, XVIIIe-XXIe siècles : éloge de la virtuosité, Dijon, Faton, 2014.
FENAILLE Maurice, CALMETTES Fernand, État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu’à nos jours, 1600-1900, Paris, Hachette, 1903.
FROISSART Cyrille, « La porcelaine d’Orléans (1753-1782) et l’attribution des marques au lambel », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 8, 1999, p. 7-19.
GAY-MAZUEL Audrey, « Splendeurs de la faïence de Rouen », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 20, 2011, p. 35-50.
GENSOLLEN Isabelle, Le marquis de Marigny : administrateur des arts de Louis XV, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2022.
GIRARD Caroline, « Charles-Axel Guillaumot (1730-1807), architecte et administrateur de la manufacture des Gobelins », Livraisons d’histoire de l’architecture, vol. 8, n° 1, 2004, p. 97-106.
GRIL-MARIOTTE Aziza (dir.), L’artiste et l’objet. La création dans les arts décoratifs (XVIIIe-XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
GUILLEMON-BRULON Dorothée, « Porcelaine de Sèvres : le service de la princesse des Asturies », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 13, 2004, p. 53-60.
JOULIE Françoise, « Le rôle de François Boucher à la manufacture de Vincennes », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 13, 2004, p. 33-52.
LA HUBAUDIÈRE Christian de, SOUDÉE LACOMBE Chantal, « Edme Serrurier, “Entrepreneur de la Manufacture Royalle des Terres d’Angleterre établie à Paris” », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 12, 2003, p. 9-18.
LA HUBAUDIÈRE Christian de, SOUDÉE LACOMBE Chantal, « Faïences de Rouen à décor de chinoiseries d’Augsbourg », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 21, 2012, p. 46-56.
LACHAT Raymond (dir.), Mobilier national, manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, Paris, Mobilier national, manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, 1993.
LE DUC Geneviève, PLINVAL DE GUILLEBON Régine de, SOUDÉE LACOMBE Chantal, « Contribution à l’étude de la manufacture de Saint-Cloud pendant ses cinquante premières années », Keramik-Freunde der Schweiz, n° 105, 1991.
LE DUC Geneviève, « Des collections royales et princières de porcelaine (1650-1750) », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 4, 1995, p. 15-23.
LEHMAN Christine, « Les lieux d’activité du chimiste Pierre-Joseph Macquer (1718-1784) : laboratoires et instruments », Revue d’histoire des sciences, vol. 72, n° 2, s. d., p. 221-254.
LEHNER-JOBST Claudia, Wiener Porzellan 1718–1864, Salzbourg, Residenz Verlag, 2018.
MAIRE Christian, « Quelques repères de l’histoire méconnue d’une céramique née au XVIIIe siècle : la faïence fine », n° 10, 2001, p. 45-51.
MARCHAND Suzanne L., A History from the Heart of Europe, Princeton, Princeton University Press, 2020.
MAXWELL Christopher, French Porcelain of the Eighteenth Century at the V&A, Londres, V&A Publishing, 2009.
MELEGATI Luca, « Figurines de porcelaine italienne à Sèvres », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 7, 1998, p. 7-12.
MINARD Philippe, La fortune du colbertisme : État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.
MONTANARI Tomaso, ZIKOS Dimitrios, La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo di statue, Florence, Mandragora, 2017.
PERRIN KHELISSA Anne, « Présents et achats de porcelaines de Sèvres pour les Spinola », Sèvres, n° 15, 2006, p. 59-70.
PERRIN KHELISSA Anne, « De l’objet d’agrément à l’objet d’art. Légitimer les manufactures d’État sous la Révolution », dans Natacha Coquery, Alain Bonnet (dir.), Le commerce du luxe, Paris, Mare et Martin, 2015, p. 159-168.
PLINVAL DE GUILLEBON Régine de, « L’éveil de la porcelaine à Paris. Porcelaine tendre et porcelaine dure », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 19, 2010, p. 55-68.
PRÉAUD Tamara, ALBIS Antoine d’., La porcelaine de Vincennes, Paris, Adam Biro, 1991.
PRÉAUD Tamara, « La sculpture à Vincennes ou l’invention du biscuit », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 1, 1992, p. 30-37.
PRÉAUD Tamara, « La sculpture en couleurs à Sèvres », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 22, 2013, p. 82-88.
REMY Gérald, « Beauvais 350 ans, portraits d’une manufacture », Dossier de l’art, n° 218, 2008.
ROCHEBRUNE Marie-Laure de, « Le goût de Louis XV et de Louis XVI pour la sculpture en biscuit », Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles, vol. 22, n° 1, 2019, p. 187-204.
ROCHEBRUNE Marie-Laure de, « Les porcelaines de Sèvres envoyées en guise de cadeaux diplomatiques à l’empereur de Chine », Extrême-Orient, Extrême-Occident, vol. 43, n° 1, 2019, p. 81-92.
ŚWIETLICKA Ewa Katarzyna, « La manufacture royale de faïence de Belvédère (Varsovie) et son célèbre “Service Sultan” », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 30, 2021, p. 58-67.
SCHERER Barrymore Lawrence, « Of Meissen Men… and Women at the Frick », The Magazine Antiques, vol. 183, n° 4, 2016, p. 38-40.
WEBER Julia, « La porcelaine au service de la diplomatie. Les échanges de présents entre Dresde et Versailles », Sèvres. Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, n° 16, 2007, p. 51-61.
Catalogues d’exposition
BERTRAND Pascal-François, Aubusson, tapisseries des Lumières splendeurs de la Manufacture royale, fournisseur de l’Europe au XVIIIe siècle, (musée départemental de la Tapisserie d’Aubusson, 15 juin – 31 oct. 2013), Heule, Snoeck, 2013.
CAROLA-PERROTTI Angela, AGLIANO Andreina d’., Classici e d’invenzione : il biscuit in Italia tra rocaille e neoclassicismo, Rome, Ugo Bozzi ed., 2009.
Chefs-d’œuvre de la Manufacture royale des Gobelins au XVIIIe siècle, Arras, Musée des beaux-arts d’Arras, 1959.
FRICKER Jeanine (dir.), Charles Le Brun, premier directeur de la Manufacture royale des Gobelins, Paris, Ministère d’État, Affaires culturelles, 1962.
Les manufactures et ateliers d’art de l’État. Imprimerie nationale, Monnaies et Médailles, Sèvres, tapisseries et tapis : Gobelins, Beauvais, la Savonnerie, Besançon, Musée d’histoire du palais Granvelle, 1957.
PRÉAUD Tamara, SCHERF Guilhem (dir.), La Manufacture des Lumières. La sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Sèvres, Faton, 2015.
SARMANT Thierry (dir.), Créer pour Louis XIV : les manufactures de la Couronne sous Colbert et Le Brun, Paris, Mobilier national, 2019.
Splendeur de la peinture sur porcelaine au XVIIIe siècle. Charles-Nicolas Dodin et la manufacture de Vincennes-Sèvres, France, Éditions Artlys, 2012.
VITTET Jean, Les amours des dieux : la mythologie dans la tapisserie du XVIIe au XXe siècle, Beauvais, Galerie nationale de la tapisserie, 2004.
VITTET Jean, Tapis de la Savonnerie pour la chapelle royale de Versailles, Paris, Réunion des musées nationaux, 2006.
VITTET Jean (dir.), La tenture de l’histoire d’Alexandre le Grand : collections du Mobilier national, Paris, Réunion des musées nationaux, 2008.
VITTET Jean, BREJON DE LAVERGNEE Arnaud (dir.), La tapisserie hier et aujourd’hui : actes du colloque École du Louvre et Mobilier national et Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, Paris, École du Louvre, 2011.
VITTET Jean, Les Gobelins au siècle des Lumières : un âge d’or de la manufacture royale, Paris, Swan, 201
Lieu
Format de l'événement
Date
Appendice
Mots-clés
- manufacture, art, motif, métier, création, mobilité
Contact
- Florence Fesneau
courriel : florence [dot] fesneau1 [at] gmail [dot] com