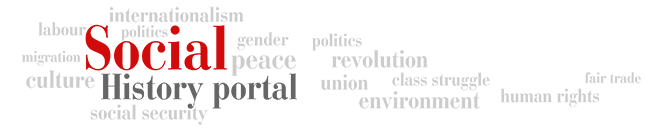Cette journée d’étude se propose d’analyser les images antifascistes dans une perspective historique et théorique, des années 1930 à aujourd’hui. Elle appelle à l’examen des relations entre antifascisme, visualité et propagande, en portant une attention particulière aux contre-régimes visuels élaborés par les mouvements antifascistes. En articulant histoire de l’art, études visuelles et sciences sociales, l’enjeu est de questionner les conditions de production, les effets et les limites opérantes des images politiques, les parcours de celles et ceux qui les ont faites, ainsi que leur rôle dans la structuration des luttes et des mémoires collectives.
ournée d’étude — 15 avril 2026, 10h–17h, Université Rennes 2
On lève le poing pour ne pas baisser les yeux. On inscrit trois flèches pour percer la peur. Face au fascisme, l’image n’est jamais un ornement : elle est un geste, un objet de mémoire, une preuve, peut-être une arme et parfois un refuge. Deux questions s’imposent alors : l’image peut-elle quelque chose contre la haine ? et à quelles conditions ?
La vie sous le fascisme est une vie sous le régime du visible : organisation des foules, chorégraphies de masse, idolâtrie du chef, culte des symboles, saturation de l’espace public. Fascisme et nazisme ont compris, avant même l’apogée des sociétés du spectacle, que le pouvoir total se conquiert aussi par les yeux. Les images y façonnent les affects, les croyances et les obéissances ; elles contribuent à dresser les corps, à resserrer les appartenances et à détruire la nuance. De Sergeï Tchakhotine (Le Viol des foules par la propagande politique) à Wilhelm Reich (Psychologie de masse du fascisme), en passant par Hannah Arendt (Les Origines du totalitarisme) et Susan Sontag (Under the Sign of Saturn), la pensée du XXᵉ siècle a analysé ce lien toxique entre propagande, pulsion, esthétique et domination.
Mais la vie antifasciste est, elle aussi, une vie d’images. Car au régime visuel de la terreur et de la haine s’est opposé, dès les années 1930, un régime visuel de la résistance. Les photomontages de John Heartfield publiés dans l’Arbeiter-Illustrierte Zeitung (AIZ), les pages engagées de Vu ou de Regards, les affiches soviétiques dessinées par Gustav Klucis ou par les ateliers du PCF, les typographies militantes de Michel Adam ou les constructions graphiques de César Domela ont activé une autre fonction de l’image : désapprendre la peur, armer les consciences, rendre visible l’injustice, ouvrir un horizon. Dans d’autres contextes, les affiches anti-franquistes, les images d’Emory Douglas pour le Black Panther Party, les visuels de l’Anti-Nazi League par David King ou encore de Rock Against Racism, prolongent cette généalogie d’un antifascisme visuel transnational et pluricontextuel.
L’histoire visuelle de l’antifascisme s’est aussi écrite par des gestes et des symboles. Le poing levé — dont Gilles Vergnon a retracé l’histoire (« Le “poing levé”, du rite soldatique au rite de masse ») — devient, au XXᵉ siècle, le signe partagé d’une communauté résistante, d’un corps collectif qui refuse l’humiliation. Les trois flèches de l’Eiserne Front (1931), conçues comme contre-signe face à la croix gammée, tout comme le triangle rouge — symbole ouvrier devenu marque infamante dans les camps nazis, puis réapproprié par les antifascistes de la fin du XXᵉ siècle dans un geste de retournement du stigmate — rappellent que l’antifascisme produit lui-même des images-slogans, capables de circuler, d’être reprises, transformées et de survivre aux contextes qui les ont vues naître. Mais plus encore que ces signes synthétiques, la production iconographique antifasciste se caractérise par un large répertoire d’images et de pratiques formelles. Du dessin de presse au photomontage, de l’affiche au journal militant, ces pratiques composent une grammaire visuelle dense de la contestation antifasciste.
Aujourd’hui encore, la question demeure brûlante. À l’heure où l’extrême droite progresse en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Inde et au-delà, les artistes, graphistes, photographes, collectifs et mouvements sociaux réinvestissent la bataille du visible : productions contre-culturelles, altermondialistes, écologistes, graphismes contre les raids de l’ICE, luttes antiracistes, sérigraphies militantes, iconographies féministes et antifascistes, archives militantes remobilisées. Ces pratiques peuvent être éclairées par les réflexions critiques sur le regard comme pratique politique — des réflexions que bell hooks a prolongé en formulant, dans Black Looks, le concept de « regard oppositionnel », ce droit conquis de voir autrement, de regarder contre, de détourner le regard du pouvoir pour l’adresser aux vies qu’il cherche à effacer (Black Looks: Race and Representation). Dans cette lignée, Nicholas Mirzoeff (The Right to Look) a montré que regarder peut devenir un acte de désobéissance visuelle, une manière de contester la visualité autoritaire qui structure les régimes contemporains de domination. Regarder devient alors un contre-geste politique.
Mais les images antifascistes ne se définissent pas seulement par les regards qu’elles induisent. S’il existe un droit de regarder, il existe tout autant un droit de montrer, dont l’importance est décisive dès lors qu’il inaugure une pratique fondamentalement oppositionnelle. Faire exister des images antifascistes implique une multitude d’arbitrages matériels dans des contextes difficiles voire hostiles : il faut les produire, anticiper leurs effets, faire des choix de cadrage et des choix formels — autant de décisions dont les implications peuvent être lourdes. Dans bien des situations, ces choix engageaient ou peuvent engager des risques concrets, la captivité, la torture ou la mort demeuraient ou peuvent demeurer des issues possibles.
Au-delà de leur charge symbolique, ces images posent une question centrale : que font-elles réellement, et à qui ? L’histoire de l’antifascisme visuel ne peut être comprise sans interroger leurs effets, leurs usages, leurs circulations et leur réception. Certaines images mobilisent, d’autres laissent indifférent, d’autres encore sont récupérées ou neutralisées. Jamais elles n’agissent seules : leur existence et leurs effets dépendent de conditions matérielles, de rapports de force, d’espaces de diffusion et de communautés de regardeurs. Dans cette perspective, l’attribution d’une agentivité aux images, telle que l’a proposée Alfred Gell, permet de penser leur capacité à participer à la production d’événements ou de comportements, à condition de rappeler que cette agentivité est toujours relationnelle, située et non autonome. Une affiche ne fait rien par elle-même : elle fait signe parce qu’une lutte existe déjà, parce qu’un territoire la rend visible, parce que des mains l’ont produite, posée, reproduite, risquée. Son efficacité potentielle est toujours conditionnelle, située, relative aux possibilités matérielles et politiques de son apparition ; mais aussi aux parcours, compétences et sensibilités de leurs autrices et auteurs.
Cette compréhension située de l’acte d’image peut être mise en relation avec l’analyse gramscienne de « l’hégémonie culturelle », selon laquelle le pouvoir se maintient notamment par la stabilisation de formes symboliques et de cadres de perception partagés. Les images antifascistes interviennent alors dans une lutte visant à déstabiliser des dominations visuelles et idéologiques. Dans une perspective complémentaire, Walter Benjamin a montré que le fascisme tend à esthétiser la politique, tandis que les usages antifascistes de l’image relèvent d’une politisation du visible (L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique). Le photomontage, la presse illustrée ou l’affiche ne cherchent pas une persuasion directe, mais fonctionnent comme des dispositifs de rupture et de désajustement perceptif, capables de désorganiser une hégémonie visuelle, mais aussi d’ouvrir de dénaturaliser des situations et dès lors d’ouvrir des perspectives. Enfin, comme l’a montré Carlo Ginzburg (Peur, révérence, terreur. Quatre essais d’iconographie politique) à partir de la notion de Pathosformeln d’Aby Warburg, l’efficacité politique des images tient aussi à la survivance et à la réactivation de formes affectives — gestes, expressions, schèmes visuels — capables de condenser des émotions telles que la peur, la révérence ou la colère. Ces formules pathétiques, réinvesties dans des contextes historiques différents, contribuent à la puissance d’évocation et de mobilisation des images antifascistes, tout en rappelant que leurs effets reposent sur des héritages visuels longs, instables et toujours susceptibles d’être rejoués ou retournés.
C’est en ce sens que, comme le rappelle Jacques Rancière, l’image politique ne produit jamais d’effet matériel direct : elle agit en reconfigurant un partage du sensible, c’est-à-dire les formes de visibilité, de parole et d’audibilité qui organisent un ordre social (Le Partage du sensible). L’image ne renverse pas le fascisme, mais elle peut contribuer à transformer les perceptions, les subjectivités et les cadres du pensable, pour qui les voit mais aussi pour qui les fait exister. Herbert Marcuse l’a formulé avec justesse : « l’art ne peut pas changer le monde, mais il peut contribuer à changer la conscience et les pulsions des hommes et des femmes qui pourraient changer le monde » (Marcuse, La dimension esthétique, 1979, p. 45). L’efficacité d’une image antifasciste se mesure ainsi moins à son intention qu’à sa capacité à déplacer la perception, à ouvrir un espace sensible et à donner forme à des pratiques de lutte plus frontales.
Interroger ces images, c’est donc poser la question de leur puissance modeste mais réelle, leurs limites, les conditions de leur existence et de leur réception : qui les réalise ? Comment sont-elles perçues ? Par qui ? Dans quelles circonstances ? Que produit leur présence — ou leur absence — dans l’espace public ? Et que nous apprennent leurs succès, leurs détournements ou leurs échecs sur les manières dont nos sociétés organisent et disputent le visible ? Quelles traces laissent-elles dans nos mémoires ? Car l’étude des images antifascistes invite aussi à une réflexion sur la mémoire, ses usages et ses conflits. Les images circulent dans le temps autant que dans l’espace, se reconfigurant au fil des contextes de réception et des luttes mémorielles. L’« Affiche rouge », représentant dix résistants du groupe FTP-MOI mené par Missak Manouchian, en offre un exemple paradigmatique : conçue comme instrument de propagande nazie, elle a été réinvestie depuis comme symbole mémoriel de la résistance antifasciste. Ce retournement rappelle que le sens politique des images n’est jamais stable, mais toujours rejoué dans le temps, faisant de la mémoire elle-même un terrain de confrontation politique. Entre archives et répertoires, entre conservation matérielle et transmission incarnée des gestes, des symboles et des affects, les images antifascistes fonctionnent comme des collisions mémorielles, où se superposent des temporalités hétérogènes.
Interroger ces images, c’est dès lors s’intéresser non seulement à leur efficacité présente, mais aussi à leur capacité à inscrire les luttes dans la durée, à structurer des récits collectifs, à nourrir des affects partagés — et à faire de la mémoire elle-même un terrain de confrontation politique. Comment agissent-elles sur les émotions, sur les imaginaires, sur les actions ? Quelles formes de reconnaissance, de refus, de malaise ou d’identification produisent-elles ? Et que nous disent l’analyse de leur diffusion, de réception par le public, par les pouvoirs de la manière dont nos sociétés fabriquent et distribuent le visible ?
Dès lors, plusieurs questions structurent cette journée :
- Qu’est-ce qu’une image antifasciste ?
- Que peut (ou ne peut pas) l’image contre le fascisme ?
- Comment les symboles antifascistes circulent-ils, se transforment-ils, se rejouent-ils ?
- Quelle vie esthétique, sensible et matérielle sous le fascisme ? Quelle vie antifasciste dans et par les images ?
- L’image protège-t-elle, mobilise-t-elle, arme-t-elle ? Peut-elle participer au soin ? Au deuil ? À la réparation ? À l’entretien de la mémoire ? Quel effet peut avoir une même image vue dans des temps et des contextes différents ?
- Comment ces images deviennent-elles motrices, contribuant à mettre en mouvement, et que révèle leur réception de nos régimes du visible ?
- Qui sont celles et ceux qui ont fait ou font de telles images ? Qu’est-ce qui les meut ? Qu’est-ce que les images leur font ?
La journée d’étude sera organisée selon un découpage chronologique, afin de permettre une étude des images antifascistes dans des contextes différents : années 1930-1950, années 1960-1980, années 1990-2020 ; chacune de ces séquences étant traversées par des dynamiques plurielles. En effet, dans une phase pré-fasciste, les images antifascistes s’attachent à empêcher l’avènement de la gouvernementalité fasciste, dans une phase de domination fasciste, elles visent à en saper l’hégémonie, tandis que dans une phase post-fasciste elles travaillent la mémoire des périodes sombres en tâchant d’empêcher la résurgence de forces fascistes. Ces trois phases ne se succèdent pas mécaniquement, mais se superposent et se rejouent dans chacun des contextes étudiés. Des années 1930 à 1950, la montée du nazisme et des fascismes, puis leurs positions de pouvoir, suscitent des réactions vives des fronts populaires et de certaines oppositions chrétiennes notamment qui trouvent une conclusion temporaire avec la victoire militaire des alliés. Dans les années 1960 à 1980, les régimes fascisants européens (Espagne, Portugal, Grèce) sont attaqués activement alors que des coups d’États installent des régimes dictatoriaux en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili notamment) et que des groupes fascistes font le coup de poing dans les républiques occidentales. Dans ces dernières, les mouvements révolutionnaires qui en sont les principaux opposants, craignent parfois que la répression violente des mouvements sociaux préfigure un tournant fasciste. Enfin, des années 1990 à aujourd’hui, les organisations d’extrême droite occidentales trouvent un nouveau souffle et sortent de la marginalité politique, certaines tendances cherchent à conquérir le pouvoir par la voie électorale en travaillant une image de respectabilité, tandis que des groupuscules violents modifient leurs pratiques, notamment de communication, à la nouvelle donne sociale et à la tolérance grandissante envers leurs agressions physiques et verbales. En face, un nouvel antifascisme cherche à trouver ses formes en passant des esthétiques anarcho-punk ou « chasseurs de skins », dominantes dans les années 1990, à celles beaucoup plus variées des tendances actuelles du mouvement social.
Trois périodes, trois panels
- Panel 1 — 1930–1950 Révolution espagnole, Eiserne Front, Résistances, antifascismes visuels européens, John Heartfield, Fronts populaires, iconographie clandestine.
- Panel 2 — 1960–1980 Circulations visuelles transnationales : Black Panther Party, Jeune Peinture, luttes latino-américaines, révolutions portugaise et grecque, Angleterre antiraciste, contre-cultures, période punk.
- Panel 3 — 1990–2026 (aujourd’hui) Nouvelles iconographies antifascistes, artistes contemporains, luttes antiracistes, migrations, réseaux sociaux, nouvelles matérialités.
Les propositions de contributions s’intéresseront à l’un ou l’autre des contextes évoqués ci-dessus, en ne s’interdisant pas de traiter d’expériences qui échappent aux listes précédentes et en n’hésitant pas à travailler la circulation des images d’un contexte à l’autre et l’évolution afférente du sens des images.
Le fascisme organise le visible pour mieux contraindre les vies. L’antifascisme, lui, redistribue les regards pour rouvrir le champ du possible. Cette journée d’étude invite chercheur·ses et artistes à interroger ce champ de bataille visuel, à historiciser ses formes, à penser ses circulations et à questionner son efficacité. Il y va de l’histoire, mais aussi de notre présent.
Modalités de contribution
- Format : interventions de 30 à 45 minutes en français ou en anglais
- Envoi des propositions (1 500–2 000 signes) : avant le 15 février à prote-rabcorr@proton.me
Sélection
Thomas Bertail, Jil Daniel et Florent Perrier (Rennes 2, PTAC)
Organisation
Thomas Bertail (HCA – Bibliothèque Kandinsky, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou) et Jil Daniel (Rennes 2, AIAC)
Bibliographie non exhaustive
Arendt Hannah, Les Origines du totalitarisme, trad. de l’anglais par Jean-Loup Bourget, Paris : Gallimard, coll. « Quarto », 2002 [The Origins of Totalitarianism, San Diego : Harcourt Brace & Co., 1951].
Arendt Hannah, La Crise de la culture, trad. de l’anglais par Patrick Lévy, Paris : Gallimard, coll. « Folio essais », 1972 [Between Past and Future, New York : The Viking Press, 1961].
Arendt Hannah, La Nature du totalitarisme, trad. de l’anglais par Michelle-Irène Brudny, Paris : Payot, 2018 [1954].
Auther Elissa et Lerner Adam (dir.), West of Center Art and the Counterculture Experiment in America, 1965-1977, Denver-Minneapolis : Museum of Contemporary Art Denver-University of Minnesota Press, 2012.
Bartholeyns Gil (dir.), Politiques visuelles, Dijon : Les Presses du réel, 2016.
Bartholeyns Gil., Dierkens Alain. et Golsenne Thomas (dir.), La Performance des Images, Bruxelles : Université de Bruxelles, 2010.
Baussant Michèle (dir.), « Mémoires plurielles, mémoires en conflits ». Ethnologie française, vol. 37, n° 3, 2007.
Benjamin Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, trad. de l’allemand par Maurice Gandillac, Paris : Gallimard, 2000 [Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936].
Berger John et al., Ways of seeing. Based on the BBC television series, Londres : British Broadcasting Corporation / Penguin Books, 1972.
Bonhomme Max, Propagande graphique : photomontage et culture de l’imprimé dans la France des années 1930, Paris : Sorbonne, 2025.
Bonhomme Max & Théret Aline, Couper, coller, imprimer, le photomontage politique au XXe siècle, (cat. d’exp., Nanterre, La Contemporaine, 19 nov. 2025-14 mars 2026), Paris : Anamose, Nanterre : La Contemporaine, 2025.
Boidy Maxime et Martinez Tagliavia Francesca, Visions et visualités. Philosophie politique et culture visuelle, Paris : Poli, 2018.
Boidy Maxime, « Luttes de représentation, luttes de visibilité », Hybrid [En ligne], 4 | 2017, mis en ligne le 04 septembre 2017, consulté le 12 janvier 2024. URL : http://journals.openedition.org/hybrid/917
Bredekamp Horst, Théorie de l'acte d'image (trad. De l’allemand par Frédéric Joly), Paris : La Découverte, 2015.
Colon David, Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain, Paris, Belin, 2019.
Désanges Guillaume & Piron François (dir.), Contre-cultures 1969-1989, l’esprit français, (cat. d’exp., Paris, Maison rouge, 24 fév.-21 mai 2017), Paris : La Maison rouge & La Découverte, 2017.
Désanges Guillaume & Piron François (dir.), Contre-vents, (cat. d’exp., Saint-Nazaire : Le Grand Café, 26 mai-29 sept. 2019) Paris : Paraguay Press, Saint-Nazaire : Le Grand Café, 2021.
Galimberti Jacopo. Individuals agains Individualism, Liverpool : Liverpool University press, 2017.
Gell Alfred, L’art et ses agents. Une théorie anthropologique, trad. fr. Sophie et Olivier Renaut, Dijon : Les presses du réel, 1998 [Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998].
Gervereau Laurent et Peschanski Denis (dir.), La Propagande sous Vichy, 1940-1944, (cat. exp. Paris, Hôtel national des Invalides, Musée d’histoire contemporaine de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, 17 mai-21 juil. 1990), Nanterre : BDIC, 1990.
Ginzburg Carlo, Peur, révérence, terreur. Quatre essais d’iconographie politique, trad. de l’anglais et de l’italien par Martin Rueff, Dijon : Les Presses du réel, 2013.
Gourevitch Jean-Paul, L’imagerie politique, Paris : Flammarion, 1980.
Gramsci Antonio, Cahiers de prison. Anthologie, Paris, Gallimard, 2021.
Gramsci Antonio, L’hégémonie culturelle (trad. de l’italien par Françoise Bouillot), Paris : Payot, 2024.
Herf Jeffrey, Le Modernisme réactionnaire : Haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme, trad. de l’anglais par Frédéric Joly, Paris : L’Échappée, 2018 [Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge : Cambridge University Press, 1984].
hooks bell, Black Looks: Race and Representation. Boston : South End Press, 1992.
Joschke Christian, « À quoi sert l’iconographie politique ? », Perspective, no. 1, 2012, mis en ligne le 30 décembre 2013, consulté le 27 juin 2024. [En ligne] URL : http://journals.openedition.org/perspective/646.
Létourneau Jocelyn et Jewsiewicki Bogumil, « Politique de la mémoire », Politique et Sociétés, vol. 22, n° 2, 2003, p. 3-15. https://doi.org/10.7202/007871ar
Marcuse Herbert, La dimension esthétique. Pour une critique de l’esthétique marxiste, trad. fr. D. Coste, Paris : Seuil, 1979 [Die Permanenz der Kunst: Wider eine bestimmte Marxistische Aesthetik, Munich : Carl Hanser Verlag, 1977].
Mirzoeff Nicholas, The Right to Look: A Counterhistory of Visuality, Durham : Duke University Press, 2011.
Mitchell W.J.T., Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
Perrot Raymond, Le collectif antifasciste 1974-1977, Paris : EC, 2001.
Rosell Wally (dir.), Espagne 36 : les affiches des combattant-e-s de la liberté [tome 1], Saint-Georges-d'Oléron : Editions libertaires, 2005.
Rosell Wally (dir.), Espagne 1936-1975 : Les affiches des combattant·e·s de la Liberté [tome 2], St-Georges d'Oléron : Les Editions Libertaires, 2007.
Sontag Susan, Sous le signe de Saturne, trad. Fabienne Durand-Bogaert, Paris : Christian Bourgois, 1985 [Under the Sign of Saturn, New York : Farrar, Straus and Giroux, 1980].
Sontag Susan. Regarding the Pain of Others. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003.
Sontag Susan. Devant la douleur des autres. Trad. Fabienne Durand-Bogaert, Paris : Christian Bourgois, 2003 [Regarding the Pain of Others. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003].
Sturken Marita et Cartwright Lisa (dir.), Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford : Oxford University Press, 2001.
Rancière Jacques, Le Partage du sensible, Paris : La Fabrique, 2000.
Rancière Jacques, Les Temps modernes, Paris : La Fabrique, 2018.
Reich Wilhelm, La Psychologie de masse du fascisme, Paris, Payot, 1998 [Die Massenpsychologie des Faschismus, Copenhague : Verlag für Sexualpolitik, 1933].
Lefranc Sandrine, « La mémoire collective est une construction politique », CNRS Le Journal, 8 février 2023. [En ligne] consulté le 12 mai 2025, URL : https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-memoire-collective-est-une-constr…
Tchakhotine Sergeï, Le Viol des foules par la propagande politique, Paris : Gallimard, 1939.
Vergnon Gilles, « Le “poing levé”, du rite soldatique au rite de masse. Jalons pour l’histoire d’un rite politique », Le Mouvement social 195, vol. 3, n° 212, 2005, p. 77-91.
Warburg Aby, The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the European Renaissance (trad. de l’allemand par David Britt), Los Angeles : Getty Research Institute, 1999 [Die Erneuerung der heidnischen Antike: Kulturwissenschaftliche Beitrage zur Geschichte der europaischen Renaissance, Leipzig: B. G. Teubner Verlag, 1932].
Warburg Aby, L’Atlas Mnémosyne, (éd. Martin Warnke et Claudia Brink, trad. de l’allemand par Sacha Zilberfarb), Paris : L’écarquillé / INHA, 2012.
Zervigón Andrés Mario, John Heartfield and the Agitated Image: Photography, Persuasion, and the Rise of Avant-Garde Photomontage, Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
Lieu
- Université Rennes 2
Rennes, France (35)
Format de l'événement
Hybrid event (on site and online)
Date
Fichiers attachés
Mots-clés
- image politique, fascisme, antifascisme, culture viuelles études culturelles, études visuelles, graphisme