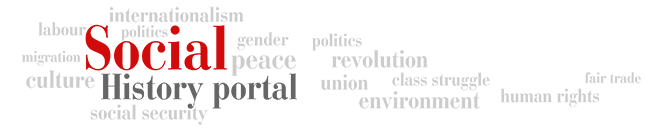Paris/France
La « bataille culturelle » se traduit par une banalisation des discours d’extrême droite qui se répandent dans les médias traditionnels, les réseaux sociaux, les industries culturelles. Ce colloque propose d’interroger les ressorts d’une résurgence des extrêmes droites au prisme de l’ordinaire, en s’intéressant pour cela aux liens entre hybridations idéologiques, médias et culture. Il s’inscrit dans une approche interdisciplinaire, au croisement des sciences de l’information et de la communication, de la sociologie, de la science politique et des Cultural Studies, afin de privilégier les approches communicationnelles et culturelles des phénomènes politiques contemporains.
Argumentaire
Le développement spectaculaire de l’autoritarisme politique auquel nous assistons dans les pays démocratiques repose en grande partie sur un travail au long cours de préparation des esprits à un changement radical de perspectives par rapport au compromis social-démocrate instauré au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Si le « populisme autoritaire » des néolibéraux thatchériens, très tôt décrit par Stuart Hall (1979/2008), représente une étape significative de détachement par le haut des idéaux progressistes, des racines encore plus lointaines peuvent être identifiées aux Etats-Unis, dans le rejet des nouveaux droits civiques, dès la présidence Nixon (Grossberg, 2019) et dans l’invention de l’idée de « guerres culturelles » promue par des mouvements conservateurs et réactionnaires depuis les années 1970 (selon l’étude séminale de James Davison Hunter, 1991). Ces mouvements travaillent à instiller un sentiment de victimisation dans les publics majoritaires et à désigner des populations bénéficiant de droits exorbitants - les immigrés, les gays, les femmes, les pauvres… - en bousculant ainsi l’agenda des partis politiques, en contraignant les croyances religieuses. Au même moment, en France, en même temps que l’affirmation électorale du Front National et sa reprise de ces méthodes, un groupuscule d’extrême droite, le GRECE, préconise une reconquête par le bas, c’est-à-dire sur le terrain culturel, au moyen d’un « ethno-différentialisme ». Il utilise dans ce contexte l’expression de « bataille culturelle », détournée de son cadre gramscien, qui théorisait finement les liens entre idéologies et consentement, au profit d’une vision héroïque et belliciste de lutte à mort entre points de vue irréductibles, la xénophobie et le racisme tenant lieu d’idéologie nouvelle à substituer aux précédentes. A l’issue de décennies de « grand repli » des discours et des politiques (Bancel, Blanchard, Boubeker, 2017), le concept même de « bataille culturelle » est devenu pour beaucoup synonyme de « victoire » des idées d’extrême droite, en rupture théorique avec le sens gramscien et sans validation empirique du sens et de la portée de cette victoire.
Il n’y a pas de doute cependant sur l’existence d’une puissante dynamique s’originant à droite, ce que le débat sur la polarisation politique, qui a beaucoup occupé la recherche ces dernières années, a eu tendance à obscurcir en postulant comme une équivalence entre des camps éternellement en conflit de valeurs, entérinant justement le récit venu de l’extrême droite d’une bataille irréductible, là où l’asymétrie est caractérisée historiquement : la polarisation des droites radicales est antérieure et fondatrice, elle permet par ailleurs de légitimer aujourd’hui le recours à l’autoritarisme. Ivan Schuliaquer et Gabriel Vommaro (2020) rappellent que les études récentes permettent de désigner les médias (ultra)conservateurs comme responsables de la polarisation dans plusieurs pays, avec une longue liste d’instruments à cet effet : la chaîne d’information câblée Fox aux États-Unis (Peck, 2019), les tabloïds racistes et xénophobes du groupe Murdoch, les médias similaires en Europe, ainsi que les médias publics contrôlés par des dirigeants populistes en Europe de l’Est (Szabó et al, 2019) ont élaboré des contenus visant à intensifier les haines bien avant que des sites numériques similaires ne se mettent à attiser les sentiments extrémistes.
Au-delà de ces constats, ce que « extrême droite » signifie dans différents contextes nationaux et dans différentes conjonctures fait l’objet d’une recherche approfondie. En parallèle des thèmes classiques comme les motivations du vote (Rouban, 2024) ou la normalisation des acteurs ou partis relevant de cette mouvance sur la scène politique (Crépon, Dézé, Mayer, 2015), une partie des travaux récents s’intéresse à la stratégie « métapolitique » déployée par ces derniers en vue d’ancrer dans le débat public leurs idées, thèmes et récits jusqu’à les rendre légitimes, voire banals. Alors que ces recherches ont le mérite d’interroger les conditionnants sociaux, symboliques et culturels favorisant la montée en puissance de ces forces conservatrices voire réactionnaires dans des contextes démocratiques, la variété des termes utilisés pour décrire le phénomène – populisme, nationalisme, radicalisme, illibéralisme, néofascisme, technofascisme, pour n’en citer que quelques-uns – témoigne du flou entourant ces expressions contemporaines. En ce qui concerne l’apparition en ligne et dans les médias en général de discours extrémistes, on trouve ainsi le terme « radicalisation » pour le cas américain (Benkler, Faris, Roberts, 2018), l’expression « alternatif d’extrême droite » (Figenschou, Ihlebæk, 2018), ou encore le qualificatif « anti-système » (Holt, 2018 et 2019). A contre-courant, la « droitisation » de la société française est analysée en partie comme un mythe par le sociologue Vincent Tiberj (2024).
La difficulté d’analyse de ce phénomène réside en grande partie dans l’hybridation idéologique croissante des « extrêmes droites » contemporaines, lesquelles se reconfigurent au contact de courants hétérogènes : antiféministes, libertariens, complotistes, identitaires, populistes (Blanc, 2016 ; Julliard, 2018 ; Mésangeau et Morin, 2022). Voire, suivant une triangulation politique spectaculaire, l’ensemble des mouvements pour l’égalité des droits et la protection des libertés individuelles, ce que traduit entre autres l’essor de mouvements fémonationalistes (Farris, 2017 ; Robert, 2024) ou homonationalistes (Puar, 2007 ; Rebucini, 2013 ; Jaunait, Le Renard, Marteu, 2013 ; Dalibert, 2018). Cette dynamique de recomposition contribue à brouiller les catégories d’analyse classiques et à renforcer, habilement, l’ancrage de ces idéologies dans les discours comme dans les pratiques ordinaires, à tel point que des recherches récentes (notamment en Allemagne) s’interrogent sur le périmètre que recouvre aujourd’hui la notion de « contre-publics ». Notion historiquement élaborée par la théorie critique, les contre-publics qu’ils soient féministes (Fraser, 1992) ou queer (Warner, 2005) étaient traditionnellement associés à des mouvements progressistes de gauche. L’avènement des réseaux sociaux et la circulation des discours réactionnaires que l’on y observe conduisent certains chercheurs à étendre l’usage de la notion de contre-publics en dehors des sphères progressistes (Venema, Schwarzenegger & Koenen, 2025 ; Cushion, 2024).
En France ou ailleurs, les formes par lesquelles les extrêmes droites investissent l’espace public dépassent le cadre institutionnel des échéances électorales ou celui de l’activisme militant (Hobeika et Villeneuve, 2017 ; Greffet et Neihouser, 2022). Loin de se réduire à un phénomène partisan, cette banalisation touche différentes sphères de la vie quotidienne : les frontières entre discours radicaux, voire haineux, et conversation ordinaire deviennent poreuses, rendant plus difficile la distinction entre ce qui relève de la transgression idéologique et ce qui procède de l’opinion acceptable. Dans les médias traditionnels, la multiplication des chaînes de la TNT ainsi que des chaînes d’information en continu, mais également des stratégies d’influence assumées par certains capitaines d’industrie contribuent à offrir de plus en plus d’espaces où ces voix se sont fait entendre à l’envi (Sécail, 2022) tout en arguant de leur prétendue marginalisation. Par ailleurs, les réseaux sociaux numériques diffusent, banalisent voire légitiment - de façon volontaire ou involontaire - des discours, des représentations et des opinions issus de ces mouvances (Rebillard, 2017 ; Bouron et Froio, 2018 ; Ouakrat 2023 ; Smyrnaios et Ratinaud, 2023). De plus, en privilégiant les affects au détriment des arguments rationnels (Bouron, 2025 ; Mercier, 2025), les acteurs des « extrêmes droites » actuelles adoptent une stratégie de banalisation plus diffuse, où ses codes, langages et imaginaires s’intègrent dans les médias généralistes, les réseaux sociaux numériques, les formes d’humour et les produits culturels populaires (Giry, 2017 ; Simon, 2024). Les institutions culturelles - musées, théâtres, festivals, salles de concert, etc. - ne sont pas en reste, les politiques culturelles étant reconfigurées, tant à l’échelle locale que nationale, dans le sens, réactionnaire, d’une croisade « anti-woke » (Bozoki, 2016 ; Négrier, 2025). Cette dynamique interroge donc profondément le rôle des médias, des industries culturelles et créatives et des dispositifs de communication non seulement dans la légitimation de ces mouvements et discours mais aussi quant au cadrage du débat public proposé car, au nom des principes mêmes qui sont au fondement de la démocratie et de l’éthique journalistique - liberté d’expression, pluralisme, représentativité, neutralité et objectivité de l’information -, des points de vue d’extrême droite, ayant pour objectif de limiter les libertés et de renforcer les inégalités, sont sollicités, banalisés voire célébrés (Lefébure, Sécail, Roche, 2024). D’autant que certaines initiatives collectives ont été mises en place, parfois avec succès à l’instar du « cordon sanitaire » politique en Belgique francophone, pour endiguer cet accaparement de l’espace public par les extrêmes droites (Biard, 2021).
Aussi, organisé par l’IRMÉCCEN, ce colloque propose d’interroger les ressorts d’une résurgence des extrêmes droites au prisme de l’ordinaire, en s’intéressant pour cela aux liens entre hybridations idéologiques, médias et culture. Il s’inscrit dans une approche interdisciplinaire, au croisement des sciences de l’information et de la communication, de la sociologie, de la science politique et des Cultural Studies, afin de privilégier les approches communicationnelles et culturelles des phénomènes politiques contemporains.
En mettant le terrain français en perspective avec d’autres situations nationales, l’objectif est d’interroger, d’un point de vue à la fois théorique et méthodologique, les différentes formes de banalisation des extrêmes droites, ainsi que les défis auxquels se confrontent les chercheur·euses pour les étudier.
Ainsi, un premier axe de réflexion mettra l’accent sur la variété et le caractère sans cesse évolutif des termes utilisés pour désigner ce phénomène, qu’il s’agisse d’appellations indigènes, avec des déclinaisons nationales centrées sur la figure du leader - trumpisme, bolsonarisme, mileisme, etc. - ou des classifications scientifiques censées en rendre compte. Dans quelle mesure des concepts tels que le populisme ou le fascisme sont-ils encore valides pour étudier la radicalisation d’extrême droite ? Comment examiner ses formes contemporaines sans cloîtrer l’analyse dans de catégories préconçues, au risque de passer à côté de ce qui fait la nouveauté et le caractère adaptatif du phénomène ?
Ces réflexions vont de pair avec les modalités de circulation, de légitimation et d’adhésion aux idées et représentations des extrêmes droites dans le contexte actuel. Un deuxième axe questionnera donc le rôle des médiations industrielles et technologiques dans les dynamiques de diffusion et de construction d’une certaine acceptabilité sociale de ces idées au sein de la société. Comment les stratégies de certains groupes industriels d’investissement et de rachats dans les secteurs de la culture et des médias convergent-elles avec des projets politiques d’extrême droite de conquête ou de consolidation du pouvoir ? Comment les médias traditionnels participent-ils, volontairement ou non, à la diffusion des thèmes et imaginaires des extrêmes droites ? Dans quelle mesure le journalisme se transforme-t-il face à ces contraintes économiques et politiques ? Qu’est-ce que cela implique d’un point de vue démocratique ? Quel rôle, pour leur part, les plateformes et pratiques numériques jouent-elles dans les dynamiques de circulation et de pénétration d’idées et l’adoption de comportements réactionnaires par les citoyennes et citoyens ? Quels types d’organisation, formats et acteurs favorisent cette dynamique et pourquoi ? Comment cela façonne-t-il des représentations politiques « par le bas », dont les effets se font également sentir lors des échéances électorales ?
Pour saisir ces enjeux, un troisième axe mettra l’accent sur la manière dont les mondes de la culture sont, eux aussi, investis par ces imaginaires politiques. Quelles stratégies tout à la fois rhétoriques, narratives et esthétiques sont déployées pour combattre et/ou subvertir des dispositifs, pratiques et milieux professionnels assimilés au progressisme et, pour le dire vite, au « wokisme » ? Dans quelle mesure une esthétique (néo)fasciste pénètre-t-elle ou instrumentalise-t-elle la culture populaire ? Par quels moyens affichés ou détournés des pressions politiques ou économiques s’exercent-elles pour censurer les expressions artistiques engagées en faveur de l’inclusion et de l’égalité des droits ou réécrire l’histoire - dans les musées par exemple - dans un sens réactionnaire ? A l’inverse, dans quelle mesure les institutions, mondes professionnels et pratiques liés à la culture peuvent-ils être des leviers de résistance face à la montée des forces réactionnaires dans l’espace public ?
Enfin, un quatrième axe accueillera des réflexions sur les publics des extrêmes droites, afin d’interroger leur rôle dans le processus de banalisation des idées, représentations et discours portés par ces dernières. Peut-on homogénéiser les caractéristiques des publics militants et sympathisants des extrêmes droites aujourd’hui ? Quelle place les publics non militants jouent-ils dans le processus d’amplification des imaginaires des extrêmes droites contemporaines ? Comment leurs visions du monde sont-elles reçues, appropriées, voire resignifiées par différents segments sociaux, culturels et générationnels ? Pourquoi des questions de société, celles relatives aux rapports de genre et aux identités, notamment, deviennent-elles des terrains féconds pour les extrêmes droites contemporaines ? Dans les espaces des discussions « ordinaires », hors ou en ligne, comment s’expliquent des dynamiques d’adhésion ou de rejet à l’égard des idées d’extrême droite ? Où se situent les ambiguïtés (on pense par exemple à l’ambivalence de certaines formes d’humour) ? Quels y sont les points de contact, de dialogue, ou à l’inverse d’affrontement et de polémiques ? Quels sont enfin les facteurs favorisant la circulation transnationale des formes et des idées d’extrême droite, tout en les articulant à des particularismes nationaux ?
Axes du colloque
- Axe 1 - Entre glissements sémantiques et évolutions historiques : quels cadres conceptuels pour penser l’« extrême droitisation » aujourd’hui ?
- Axe 2 - Stratégies politiques, économiques et éditoriales : la résistible ascension de l’extrême droite dans les médias
- Axe 3 - La culture dans le viseur : révisions et résistances
- Axe 4 - Les publics des extrêmes droites : appropriations, confrontations, circulations
Modalités de contribution
Les communications, d’une durée de 20 minutes, pourront se faire en anglais ou en français.
Les propositions de communication doivent comprendre un titre, le nom et l’affiliation des auteurs, un exposé synthétique du projet de communication (3.000 signes max.) et un bref CV scientifique (2.000 signes max.) à envoyer avant le 10 janvier 2026 à l’adresse suivante : colloque.irmeccen@gmail.com
L’Irméccen prenant en charge l’organisation du colloque, la participation est libre de droits d’inscription.
Colloque - Université Sorbonne Nouvelle, 24 et 25 juin 2026
Comité scientifique
- Bouron Samuel, Université PSL, IRISSO
- Sébastien Broca, Université Paris 8, CEMTI
- Christine Chevret Castellani, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
- Thierry Giasson, Université de Laval (Québec), GRCP
- Jayson Harsin, American University of Paris, AUP
- Mireille Lalancette, Université de Laval (Québec), GRCP
- Arnaud Mercier, Université Paris Panthéon-Assas, CARISM
- Julien Mesangeau, Université De Lille, GERIICO
- Franck Rebillard, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
- Ivan Schuliaquer, CONICET et Universidad Nacional de San Martin (Argentine)
- Claire Secail, CNRS-Universités Paris Cité et Sorbonne Nouvelle, CERLIS
- Paola Sedda, Université De Lille, GERIICO
Comité d’organisation
- Aurélie Aubert, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
- Jamil Dakhlia, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
- Eric Maigret, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
- Camila Moreira Cesar, Université Sorbonne Nouvelle, IRMÉCCEN
Bibliographie
Bancel N., Blanchard P., Boubeker A.. Le grand repli. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, La Découverte, 2017.
Benkler Y., Faris R., Roberts H., Network Propaganda. Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics, Oxford University Press, 2018.
Biard, B. « La lutte contre l’extrême droite en Belgique I. Moyens légaux et cordon sanitaire politique », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2522-2523(37), pp. 5-114, 2021.
Blanc C., « Réseaux traditionalistes catholiques et “réinformation” sur le web : mobilisations contre le “Mariage pour tous” et “pro- vie” », Tic & société, 2016, vol. 9, n° 1-2.
Bouron S., Politiser la haine. La bataille culturelle de l’extrême droite identitaire, La Dispute, 2025
Bouron S., Froio C., « Entrer en politique par la bande médiatique ? Construction et circulation des cadrages médiatiques du Bloc identitaire et de Casapound Italia », Questions de communication, 2018, n° 33.
Bozoki, A. « Mainstreaming the Far Right Cultural Politics in Hungary ». Revue d’études comparatives Est-Ouest, No 47(4), pp. 87-116, 2016.
Cushion S., Beyond Mainstream media : alternative media and the future of journalism , 2024, London, Routledge.
Crépon S., Dézé A., Mayer N. (dir.), Presses de Sciences Po, 2015, Les faux- semblants du Front National. Sociologie d’un parti politique
Dalibert, M. « En finir avec Eddy Bellegueule dans les médias Entre homonationalisme et ethnicisation des classes populaires ». Questions de communication, 33(1), pp. 89-109, 2018.
Farris S. R., Au nom des femmes. « Fémonationalisme ». Les instrumentalisations racistes du féminisme, Syllepse, coll. Nouvelles questions féministes, 2021 [2017].
Figenschou T., Ihlebæk K., « Challenging Journalistic Authority : Media criticism in far- right alternative media », Journalism Studies, 2018, vol. 20, n° 9.
Fraser N., « Repenser la sphère publique, une contribution à la démocratie telle qu’elle existe réellement », Extrait de Habermas and the Public Sphere, sous la direction de Craig Calhoun, Cambridge, MIT Press, 1992, p. 109-142, traduit de l’anglais par Muriel Valenta, Hermès 2001/3 n° 31, p. 125-156
Giry J., « Le complotisme 2.0, une étude de cas d’une vidéo recombinante : Alain Soral sauve Glenn et Tara dans The Walking Dead », Quaderni, 2017, n° 94.
Greffet F., Neihouser M., « Battre la campagne numérique. Les recompositions des activités électorales à l’heure de la digitalisation », Politiques de communication, 2022, n° 19.
Grossberg L., Under the Cover of Chaos : Trump and the Battle for the American Right, Pluto Press, 2019.
Hall S., Le populisme autoritaire, Éd. Amsterdam, 2008.
Hobeika A., Villeneuve G., « Une communication par les marges du parti ? Les groupes Facebook proches du Front National », Réseaux, 2017, n° 202-203.
Holt K., « Alternative Media and the Notion of Anti- Systemness : Towards an Analytical Framework », Media and Communication, 2018, vol. 6, n° 4.
Holt K., Rightwing alternative media, Routledge, 2019.
Hunter J-D., Culture Wars : The Struggle To Define America, Basic Books, 1991.
Jaunait, A., Le Renard, S.-A., Marteu, É., « Nationalismes sexuels ? Reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes », Raisons politiques, 49(1), pp. 5-23, 2013.
Julliard V., « L’idéologie raciste en appui aux discours antiféministes : les ressorts émotionnels de l’élargissement de l’opposition à la « théorie du genre » à l’école sur Twitter. Les Cahiers du genre, n° 65, 2018
Lefébure P., Sécail C. et Roche E., « Au nom du pluralisme. Polarisation et droitisation de la campagne présidentielle de 2022 dans les médias audiovisuels », Politiques de communication, n° 22, 2024/1.
Mercier A., Les mots de la désinformation et de la manipulation, Presses Universitaires du Midi, 2025.
Mésangeau J. et Morin C., « Les discours complotistes de l’antiféminisme en ligne » Mots, 2022/3 n° 130.
Négrier, E., « Le projet culturel du Rassemblement national ». Le Droit de Vivre, 694(1), pp. 96-99, 2025.
Ouakrat A., « Des discours de haine au cœur du débat public. La contribution des médias à la circulation des polémiques de Valeurs actuelles », Réseaux, 2023, n° 5.
Peck R., Fox populism : Branding conservatism as working class, Cambridge University Press, 2019.
Puar J.K., Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times. Durham et Londres : Duke University Press, 2007.
Rebillard F., « La rumeur du PizzaGate durant la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Les appuis documentaires du numérique et de l’Internet à l’agitation politique », Réseaux 2017/2, n° 202-203
Rebucini, G. « Homonationalisme et impérialisme sexuel : politiques néolibérales de l’hégémonie ». Raisons politiques, 49(1), pp. 75-93, 2013.
Robert, J. « Quand l’extrême droite instrumentalise les discours féministes ». La Revue Nouvelle, 4(4), pp. 96-102, 2024.
Rouban L. Les Ressorts cachés du vote RN, Presses de Sciences-po, 2024.
Sécail C., Touche pas à mon peuple, Seuil, 2023.
Simon J, Wagener A. Introduction. Quand les mèmes deviennent un nouveau langage en politique. Engagements et logiques contestataires au prisme de l’analyse discursive. Semen - Revue de sémio-linguistique des textes et discours, 2024, Approches discursives des mèmes en politique, 54, pp. 10-24.
Smyrnaios N., Ratinaud P., « De la presse parisienne à la fachosphère. Genèse et diffusion du terme “islamo- gauchisme” dans l’espace public », Réseaux, 2023, n° 241.
Szabó, G., Norocel, O. C., Bene, M., « Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania : A Discursive Opportunity Approach. Problems of post-communism », 66(1), 33-46, 2019.
Tiberj V., La droitisation française, mythes et réalités, PUF, 2024
Venema N., Schwarznegger C. et Koenen E., « From emancipation to disinformation : Public dissent and its evaluation in change », Publizistik, 2025.
Warner M., Publics and Counterpublics, Zone Books, 2005.
- Salle Athéna - 4 rue des Irlandais
Paris, Frankreich (75005)
Format de l'événement
Événement sur place
Date limite
- Samedi 10 janvier 2026
Mots clés
- bataille culturelle, autoritarisme, démocratie, néolibéral, populisme autositaire
contact
- Aurélie Aubert
courriel : aurelie [dot] aubert [at] sorbonne-nouvelle [dot] fr