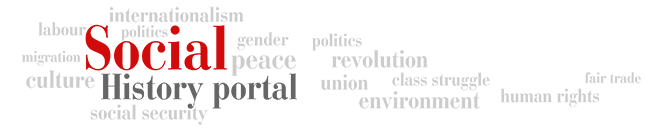Saint-Jérôme/Canada
En février 1975, à Saint-Jérôme (Québec), les travailleur·euses de la Regent Knitting reprennent leur usine de textile et inaugurent Tricofil, l’une des premières expériences d’autogestion ouvrière au Québec et sans doute celle qui marquera le plus les esprits tant par les espoirs qu’elle suscita que par les défis qu’elle rencontra. Afin de raviver et actualiser la mémoire de l’usine Tricofil nous vous invitons à participer à ce colloque en nous proposant une contribution. Nous rassemblerons des praticien·nes de la coopération du travail, des chercheur·euses, des personnes engagées en faveur de la démocratisation du travail, de acteurs·trices du mouvement de l’économie sociale et solidaire.
Argumentaire
En février 1975, à Saint-Jérôme (Québec), les travailleur·euses de la Regent Knitting reprennent leur usine de textile et inaugurent Tricofil, l’une des premières expériences d’autogestion ouvrière au Québec et sans doute celle qui marquera le plus les esprits tant par les espoirs qu’elle suscita que par les défis qu’elle rencontra (Boucher 1982 ; Grand’Maison, 1975 a, b). Comme ailleurs dans le monde à la même époque (Gourgues et Ubbiali 2023 ; Piaget, 2021 ; Gourgues et Neuschwander, 2018 ; Hatzfeld, 2011), Tricofil témoigne de l’ancrage des milieux de travail dans leur territoire, ainsi que de la volonté d’envisager la production dans un autre cadre que celui du capitalisme industriel et marchand (Dupuis et coll., 1982 ; Gagnon, 1991 ; Cyr, 2017), sans pouvoir réellement s’en désencastrer. La coopérative fera la démonstration de la capacité de prise en main de l’ensemble des fonctions de production et de gestion par les travailleur·euses eux et elles-mêmes, passant notamment par une conscientisation ainsi qu’une éducation collective aux différents secteurs d’activité de l’entreprise. Conséquemment, les difficultés éventuellement rencontrées par Tricofil vont avoir un écho bien au-delà des murs de l’usine jérômienne (Lachapelle et Furukawa Marques, 2023 ; Jacot, 1985 ; Rioux, 1982). Il importe ainsi de reconnaître sa place centrale dans la création progressive d’un écosystème de l’économie sociale et solidaire au Québec qui deviendra une composante essentielle de ce que l’on appellera le « modèle québécois ». C’est ainsi qu’aujourd’hui, de nombreuses coopératives de travail manifestent encore l’héritage de Tricofil. Ces dernières s’inscrivent dans la démarche de créer des environnements favorisant l’autonomie des personnes et en donnant un sens au travail que l’on accomplit en tant qu’individu et collectivité.
Les écrits sur les milieux de travail coopératifs et les occasions d’échanger à propos des réalités et des possibilités qui s’y déploient restent cependant marginaux (Canivenc, 2020). Souligner le cinquantenaire de Tricofil comme innovation sociale transformatrice, mais aussi comme inspiration et aspiration économiques et politiques, nous invite donc àréfléchir sur le parcours historique de l’idée et de la pratique de l’autogestion au Québec (Kruzynski, 2017 ; Drapeau et Kruzynski, 2005), et ailleurs, les expériences qu’elle rend possibles, les défis qu’elle rencontre et les retombées qu’elle génère.
Axes de réflexion proposés pour le colloque
Axe 1 : Gestion collective et démocratisation
Caractéristique de la coopération, l’autogestion peut néanmoins connaître diverses formes d’expérimentations de la démocratisation et de la justice sociale (Meister, 1961). Quelles sont les ressources dont nous disposons pour distinguer ces formes, selon leurs visées, leurs modes de participation, de divisions du travail, de formation, de collaboration et de résolutions des conflits, internes et externes (Cottin-Marx, 2024 ; Tadjine et Dazé, 2023 ; Lallement, 2019 ; Schweri, 2012 ; Guillerm et Bourdet, 1975) ? Quelles sont les articulations entre ces formes et d’autres véhicules de la démocratisation du travail, dont le syndicalisme (Cukier, 2018 ; Mothé, 1980) ? Quels sont les avantages et les limites de ces formes et quels sont les critères qui permettent d’en juger ?
Axe 2 : Défis économiques et financiers
Confrontée à d’importants défis financiers qui mèneront éventuellement à sa fermeture, Tricofil a favorisé une prise de conscience de l’importance de doter le tiers secteur de ses propres mécanismes de financement. Quels sont ces mécanismes, qu’ont-ils permis de favoriser (MacDonald et Dupuis, 2021 ; Pépin et coll., 2024) ? Où en sommes-nous, plus largement, de la démocratisation de l’économie et de la construction d’alternatives à l’économie dominante (Ballon et coll., 2023 ; Dufort et coll. 2022 ; Zerdani et Bouchard, 2016 ; Maheux, s.d.) ? Les coopératives et les entreprises de l’économie sociale parviennent-elles à assurer leur pérennité économique et à assurer de bonnes conditions d’emploi, et à quel prix (Boucher, 2024 ; Cottin-Marx, 2024) ?
Axe 3 : Écosystème de l’Économie sociale
En raison de leurs principes communs, dont la visée de répondre aux besoins de la communauté, les coopératives de travail et le monde de la coopération en général, relèvent de l’économie sociale. Cet axe propose de faire le point sur cet écosystème et d’examiner ces questions : comment les coopératives de travail se réseautent-elles entre elles ? Avec quels bénéfices et quels obstacles ? Quel rapport entretiennent-elles avec les autres formes de l’économie sociale et solidaire (OBNL, organismes communautaires ...) ? Participent-elles à la construction d’une articulation systémique de l’économie sociale, politique et écologique de demain (Dufort, 2022 ; Georgi, 2003) ?
Axe 4 : Inscription territoriale et comparaison internationale
Consacré à l’inscription territoriale de la démocratisation du travail, cet axe entend aborder les questions suivantes : comment les coopératives de travail s’inscrivent-elles dans leurs territoires (local, régional, national) ? Pourquoi la dimension locale reste-t-elle primordiale dans les expériences d’autogestion (Carrel et coll., 2020) ? Comment s’inscrivent-elles dans des projets de société plus larges (Lamarche et Richez-Battesti, 2023 ; Ruggeri, 2020 ; Cukier, 2018) ? Comment s’articulent ces projets à ceux des syndicats ou des communs (Abraham et Fourrier, 2022) et à la transition socioécologique ? Que peuvent nous enseigner les expériences françaises, espagnoles et argentines à cet égard (Vieta, 2020 ; Ruggeri, 2015 ; Quijoux, 2014) ?
Modalités de contribution
Veuillez transmettre les informations suivantes :
Votre texte de proposition, d’au plus 500 mots, décrivant votre projet de communication, de participation ou d’intervention.
Une courte biographie (125 mots maximums)
Date limite de réception : 5 décembre 2025
À transmettre à : tricofil@proton.me
Profils recherchés
Ce colloque s’adresse autant aux militant es, aux praticien nes de l’autogestion, aux syndicalistes qu’aux chercheur euses, ce qui implique une diversité de postures relativement à la connaissance et à l’expérience. Ainsi, pour favoriser l’imbrication des savoirs et la co-construction des problèmes de la pratique, la programmation a été conçue afin d’être variée, dans ses formes, et dynamique quant à l’interpellation des participant es. Aux formes classiques que sont les grandes conférences et les panels, s’ajouteront des ateliers structurés autour du partage des problèmes de la pratique et de la construction de réseaux, dans le but de dynamiser la recherche et le développement de la coopération du travail.
Dans la réponse que vous donnerez à cet appel de communication, vous êtes donc convié e à attacher autant d’importance au contenu que vous souhaitez partager qu’à la forme de ce partage. Par exemple, être disposé à contribuer (avant le colloque) à la structuration d’un atelier dans lequel des personnes, praticien nes, chercheur euses et observateur trices réfléchiraient ensemble autour de quelques défis que vous auriez identifiés et problématisés.
Comité d’organisation
Ce colloque international est organisé par le Pôle UQO du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).
- Jacques Boucher, professeur retraité (UQO) et membre émérite du CRISES
- Marie-Pierre Boucher, responsable du Pôle UQO du CRISES (crisesuqo@uqo.ca)
- Paul-André Boucher, ouvrier de la Regent Knitting, militant syndical, directeur de Tricofil et cofondateur de la Table de travail des coopératives de production, de travail et pré-coopératives, en 1979.
- Julie Châteauvert, Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales (CRITS), École d’innovation sociale Élisabeth Bruyère (Université St-Paul), et administratrice à Réseau Coop
- Thomas Collombat, Pôle UQO et Axe Travail et Emploi du CRISES
- Marie-Laure Dioh, Pôle UQO du CRISES et Chaire de recherche en économie sociale et solidaire (RRESS) ;
- Isabel Faubert, directrice générale, Réseau Coop
- Alexandre Fournier, Économie sociale des Laurentides
- André Leclerc, organisateur syndical retraité.
Lieu
- 5 Rue St Joseph
Saint-Jérôme, Kanada (J7Z0B7)
Format de l'événement
Événement sur place
Date
- Vendredi 5 décembre 2025
Mots clés
- autogestion, coopération du travail, économie solidaire, entreprises récupérées, démocratie industrielle
Contact
- Marie-Pierre Boucher
courriel : tricofil [at] proton [dot] me - Marie-Pierre Boucher
courriel : tricofil [at] proton [dot] me - Julie Chateauvert
courriel : jchateauvert [at] ustpaul [dot] ca